Un modèle mathématique
L’histoire que je rapporte ici est celle d’une étude de projet, de nature mathématique, qui s’est substituée à l’étude et à la réalisation d’un appareil prototype d’un moyen nouveau de transport, dont le promoteur Bertin a réalisé de son coté ce qu’il pouvait, avec les moyens de sa société.
En 1967 le Ministère de la Production Industrielle a demandé une étude technico-économique de ce train à grande vitesse de technique inspirée de l’aéronautique, qui m’a été confiée : l’objectif était de voir si cette innovation séduisante avait un marché, si la grande vitesse répondait à un besoin général ou à un désir du public, et dans quelle direction optimale il était indiqué de tenter sa réalisation : Vaste programme !
L’environnement externe contenait à coup sûr, sous forme potentielle, l’information à partir de laquelle on pourrait induire quels seraient les désirs futurs du public et ses besoins nouveaux susceptibles d’être satisfaits quelques décennies plus tard, s’il apparaissait sur le marché dans un avenir prévisible un véhicule de conception et de contenance similaire à celle d’une carlingue d’avion commercial, donc semblable à un autobus, à un car, capable de rapprocher deux grandes cités au point qu’on puisse dans une même journée effectuer un trajet domicile- travail aller et retour, desservi à la fréquence du métro, ou de mettre Paris à portée de la mer dans une même journée.
Mais trouver l’information nécessaire pour écrire ce futurible relevait de la science-fiction ou de la divination. Rappelons-nous l’inventeur du téléphone, Graham Bell, qui croyait que son invention aurait pour utilité principale de permettre à des mélomanes d’entendre l’opéra à domicile : et l’inventeur de la T.S.F. la télégraphie sans fil de Marconi, qui n’a pas imaginé qu’on pourrait transmettre sans fil autre chose qu’une suite de points et de traits. De nombreuses illusions créatrices d’objets de transport répondant à un besoin, un désir facilement imaginé, se manifestent fréquemment.
En revanche, il m’était possible de recueillir l’information utile pour réaliser un objet dont on possédait la maitrise et l’expérience, et pour prédire par extrapolation les propriétés de tout objet de conception voisine ; et en déduire son coût, et ses avantages compétitifs en répondant à un besoin supposé. L’imitation d’un objet existant était un moyen puissant d’obtenir cette information extrapolée.
Le concept d’une étude technico-économique, comme la science de la conception, de l’artificiel, était à l’époque dans l’enfance et se réduisait à l’utilisation des techniques de la Recherche Opérationnelle. Mais le travail demandé ne consistait qu’à évaluer l’utilisation d’un appareil n’ayant donné encore lieu à aucune exploitation, pour satisfaire des besoins et désirs qui ne s’étaient pas encore exprimés ; on pouvait seulement rechercher des trade-offs : les valeurs de caractéristiques de construction variant en sens contraire, optimisant un coût et une performance.
Ainsi, partant d’ un Aérotrain prévu de 80 places réparties en 16 rangées de 5 places, nous avons commencé par comparer les véhicules de n rangées de p places tels que n x p = 80.
L’Aérotrain «panoramique» : une seule rangée de 80 places, convenablement profilée, de 50 mètres de largeur offrait la moindre traînée, donc la moindre consommation pour la propulsion, mais la contrainte d’insertion dans l’environnement était maximale et prohibitive tant par son coût que par sa nuisance.
L’Aérotrain «serpent» : file de 80 places à la queue leu leu, avait la plus grande trainée, la consommation maximale ; son insertion dans l’environnement était minimale mais il n’en tirait pas profit, car le matériel de propulsion était déjà plus large qu’un seul siège de passager.
À la satisfaction générale le calcul du trade off plaça l’optimum à 16 rangées de 5 places ! On ne pouvait pas faire mieux. On s’interrogea sur l’utilité de ce calcul. Elle était évidente : pourquoi 80 places ? Et si le calcul avait prouvé qu’un Aérotrain serpent ou panorama était viable, voire préférable en offrant la possibilité d’un service nouveau, inédit et désiré par un certain public ?
Le principal sujet de discussion qui s’ensuivit porta sur la formulation de la fonction d’utilité définissant le service rendu à optimiser : cela revenait à calculer pour une technologie, une vitesse donnée ce qu’on appelait un «coût généralisé» : un coût du kilomètre–passager fonction des paramètres retenus, auquel on ajoutait la «valeur du temps» passé par le passager dans le train.
Dans sa conception de la grande vitesse, Bertin exposait à la DATAR qu’il fallait remplacer la notion de distance par celle du temps de transport acceptable. Dans cette perspective, un temps de transport trop long devrait être considéré comme une perte de la collectivité transportée, s’il pouvait autrement être utilisé à effectuer un travail ; la valeur du temps serait alors le coût de l’heure de travail que le passager peut fournir avec le temps économisé.
Cette conception n’est pas très éloignée de celle du philosophe Bergson, qui méditait sur le temps vécu à attendre que le morceau de sucre fonde dans son verre, et qui réfutait le paradoxe de Zénon sur Achille et la Tortue en concluant que « le temps est invention ou il n’est rien du tout[1] ». Traduction mathématique : la valeur de ce temps dont la physique ne peut pas tenir compte mais qui est significative dans une science de l’artificiel est zéro ou l’infini.
Si la valeur du temps était zéro, le mode de transport optimal, sur la liaison Paris-Lyon pour fixer les idées, serait la péniche sur le réseau fluvial, ou en se restreignant au domaine de la SNCF, l’acheminement en petite vitesse en un seul trajet de la totalité de la demande éventuelle sur un seul long train de la longueur voulue.
Si la valeur du temps pouvait augmenter indéfiniment, le mode de transport existant optimal en 1967 était l’avion d’Air Inter, qui mettait Paris à 2 heures et demie de Lyon auxquelles il fallait ajouter les temps de liaison des villes aux aéroports : c’était la performance minimale que devrait accomplir un train grande vitesse, Aérotrain ou autre.
Le calcul d’optimisation mathématique rationalisait ces considérations en quantifiant tous les coûts et en imposant au modèle comme contrainte une condition dite de Kuhn –Tucker imitant le multiplicateur de Lagrange, modèle mécanique d’une contrainte rationnelle : on recherchait le minimum du coût du trajet augmenté de la valeur du temps du passager supposé perdu en transport, en fixant la valeur à attribuer à l’unité de ce temps ; à chaque valeur fixée correspondait une vitesse optimale.
Mais était-il vraiment nécessaire d’aller vite ? Le comité de Prospective du Ministère de la Production Industrielle qui a examiné ce travail en a retenu mon interrogation sur l’intérêt des hautes vitesses. À l’époque nul ne savait quel serait l’accueil de la population : le train allait à la vitesse de 120 Kilomètres à l’heure, la SNCF ne pensait à l’augmenter que parce que l’avion commençait à la concurrencer, ainsi que l’automobile sur autoroute. Elle perdait des clients, mais elle en était encore à se demander s’il y avait vraiment des personnes intéressées par un train mettant Paris à 2 heures et demie de Lyon. Pourtant Air Inter apportait un début de réponse : il transportait déjà 500.000 clients/an, le double quinze ans plus tard.
Le modèle étudié rappela «l’argument du Petit Prince» : un marchand de pilules contre la soif attire son attention sur le temps considérable, une heure par semaine, qu’on passe à boire et qu’on pourrait économiser en ne buvant pas:
— « Moi, dit le Petit Prince, si je gagnais une heure, je marcherais tout doucement vers une fontaine ».
Traduit en temps de transport, c’était l’argument écologiste défendu par des penseurs tels qu’Ivan Illich : si l’on tenait compte du temps passé pour produire les matériaux utilisés puis pour produire des automobiles, la vitesse moyenne de ses usagers serait celle de la marche à pied ; quel temps ont-ils gagné ?
Mais cela n’allait pas à ce moment dans le sens de l’histoire : la communication, le gain de temps réalisé grâce à l’informatique, c’était perçu comme le Bien ; il en était de même de celui qui serait réalisé par la grande vitesse : non, en ces jours, le sacré identifié à la non-communication, la lenteur, la lecture, la méditation, c’était le Mal, jusqu’à nouvel ordre. Le Petit Prince qui gagnerait une heure de temps grâce à son moyen de transport, l’emploierait à l’imiter, à faire du jogging…
Le projet CO3 du TGV
En 1967, la quasi-totalité des liaisons ferroviaires était gérée par deux entreprises publiques : la SNCF et la RATP : il n’y avait plus de tramways, et un seul métro à Paris, avec un RER (réseau express régional) en gestation. La Direction des Transports Terrestres (D.T.T.) au Ministère de l’Équipement n’avait pas d’organisme de recherche. Elle avait pour vocation principale de gérer la subvention d’équilibre de la SNCF et de la RATP, notion apparentée à la valeur du temps!L’État payait par ses ressources, donc par l’impôt, la différence entre le coût réel du ticket de métro et du kilomètre de chemin de fer et le prix que l’usager acceptait de payer, enjeu social et politique. La SNCF et la RATP étaient vues par les pouvoirs publics, notamment les Finances, comme des entreprises offrant un service obsolète mais indispensable, dirigées par des techniciens compétents mais peu soucieux de l’équilibre financier. Un peu plus tard en 1970 on demanda à ces entreprises publiques de faire l’effort d’équilibrer leurs comptes.
La SNCF commença à prendre en compte le concept de la grande vitesse en 1965 : elle ne tirait pas d’enseignement utile du Capitole au delà de la conviction qu’elle pouvait réaliser une grande vitesse ; après avoir examiné un moment l’éventualité de créer une voie de chemin de fer de gabarit réduit sur une piste supplémentaire ajoutée à une autoroute, elle créa en 1966 un « Service de la recherche », qui fit travailler ensemble des économistes qu’on venait de recruter et des techniciens, en équipe avec feedback, suivant ce qu’il appelait une « approche système » : ils étudièrent systématiquement les transports terrestres à grande vitesse sur infrastructure nouvelle (Projet C03), y compris l’Aérotrain ; une équipe de techniciens de la SNCF en avait suivi le développement, et le Service de la recherche avait pris connaissance de son modèle technico-économique de 1967 avec intérêt, n’ayant pas encore d’expérience de ce mode de calcul.
La SNCF comptait environ 600 chercheurs répartis dans ses services, mais ce Service de la recherche particulier dit Service du Projet C03 qui compta 130 personnes n’avait pas vraiment pour vocation de faire de la recherche : son objectif était de définir les moyens et la nature d’une exploitation satisfaisant mieux le public.
La grande vitesse n’était pas réalisable sur l’infrastructure existante et nécessitait donc la création d’une infrastructure nouvelle. C’était le cas de l’Aérotrain qui utilisait une voie en T inversé. Alors pourquoi ne pas étudier les possibilités éventuelles d’une grande vitesse sur une infrastructure ferroviaire, éventuellement comparée à celle de l’Aérotrain, mais qui aurait eu au départ l’avantage d’être compatible avec l’infrastructure existante, alors que le passage de l’Aérotrain au réseau ancien pour les passagers qui en auraient eu besoin aurait nécessité une rupture de charge ? Avantage que la SNCF a dès l’origine présenté comme un critère décisif de choix a priori, et qui n’a jamais fait l’objet d’une étude coût-avantage selon les critères d’un modèle technico-économique comparatif : ce qui revenait à attribuer dans le calcul à cette rupture de charge un coût infini.
En 1966 un train à turbine à gaz spéciale (TGS) fut expérimenté, puis en 1968 une étude dont l’objet était de déterminer si un TGV ferroviaire était possible et rentable fut engagée : c’était donc aussi une étude technico-économique, car la conception du TGV à créer dépendait de la demande supposée. On entreprit l’étude détaillée sur un Paris-Lyon d’une demande probable, puis d’un modèle technico-économique, afin d’explorer les conditions d’une véritable mutation par rapport aux réalisations existantes : le TGV pouvait-il comporter une part importante de ligne en voie unique ? comment variait l’exploitation suivant la fréquence, la capacité des rames ?
La SNCF lança en 1967 la fabrication d’une rame TGV de 250 places dans 7 remorques entre deux motrices portant 4 turbomoteurs, rame articulée par anneau d’intercirculation, les bogies étant placées entre les caisses. Il s’agissait d’un train destiné à une expérimentation commerciale en vraie grandeur du Turbotrain, mais le Service de la recherche avait déjà acquis sur modèle la conviction que la SNCF devait faire le TGV, cela dès le mois de mai 1968, époque à laquelle il avait pu travailler sans être dérangé en raison des événements qui retenaient ailleurs l’attention des décideurs. À ses yeux la grande vitesse était possible et rentable, sa réalisation impliquait de toutes façons la nécessité de construire une infrastructure nouvelle, et il existait une solution avec une infrastructure ferroviaire compatible avec l’existante, économiquement valable selon le modèle mathématique : donc en dépit des assurances du Service de la recherche la solution Aérotrain était d’ores et déjà rejetée d’avance au motif avancé sans évaluation que sa voie était incompatible avec les voies existantes pour cause de rupture de charge, et le Service n’était intéressé que par son modèle technico-économique.
En 1968, la D. T. T. créa l’I.R.T. (Institut de Recherche sur le Transport). Informé du projet C03 de la SNCF, l’I.R.T. commanda à la Société de l’Aérotrain une étude technico-économique plus réaliste et plus fouillée qui me fut confiée, dont l’objectif précis était de voir si l’Aérotrain pouvait ou non convenir quand même à la SNCF réticente, sans considération de son réseau existant, et l’inciter à étudier la possibilité de son installation et de son exploitation. Il fallait établir un modèle pour 3 systèmes de propulsion à comparer : turbine à gaz, moteur électrique linéaire, roues pressées contre le rail de guidage. Les résultats obtenus étaient discutés devant un aréopage composé de deux représentants de la Société de l’Aérotrain, deux de la SNCF et deux de l’I. R. T.
Les représentants de la SNCF m’assuraient qu’ils étudiaient l’Aérotrain comme une option intéressante, disaient-ils. Mais je ne savais rien du futur TGV, et il ne m’a jamais été demandé, par exemple sur la ligne Paris-Lyon, de calculer le coût supplémentaire, valeur du temps comprise, pour un passager prenant l’Aérotrain pour aller à Lyon, puis devant changer de train pour continuer sur Marseille par le réseau existant, en attendant une prolongation future : cette rupture de charge, vue par ce passager, consistait en un peu de marche à pied sur les quais, et en un temps d’attente déterminé par la fréquence des trains à prendre à cette correspondance : c’était à l’époque une contrainte non négligeable de l’environnement externe, mais il est apparu par la suite qu’on pouvait l’éliminer complètement en organisant l’exploitation des trains à grande vitesse par une coordination du passage des trains de deux lignes différentes, pour qu’ils s’arrêtent au même moment à la station de correspondance, où le voyageur n’avait plus que le quai à traverser.
L’exploitation est soumise à un certain nombre de ruptures de charge acceptées comme une donnée incontournable de l’environnement externe : quand l’écartement des rails change, qu’on passe sur une voie à crémaillère parce que la pente est trop grande, (mais alors pourquoi un chemin de fer plutôt qu’un autre moyen grimpant mieux), quand il faut acheminer les voyageurs vers leur destination finale en autobus, ou quand les voyageurs doivent transiter entre un avion ou un navire et un chemin de fer, il faut bien qu’ils quittent un moyen de transport pour passer dans un autre. Pour l’exploitant, la rupture de charge est le résultat de l’inadaptation de l’environnement interne de ce moyen de transport aux dessertes finales, qui existent de toute façon.
Mais dans tous les rapports de l’époque, la SNCF a présenté une rupture de charge entre transports à grande vitesse sur des voies différentes comme une tache rédhibitoire justifiant le rejet a priori d’une innovation prometteuse, sans procéder à aucun autre examen comparatif. La SNCF avançait qu’elle gérait un réseau : pour les besoins de cette cause elle entendait par là l’ensemble existant connecté de duorails en forme de champignon pour roues guidées par un boudin latéral ; voies ferrées installées à l’origine sur les ornières creusées par des chariots à bœufs à un entre-axe de roues devenu par la suite l’écartement standard normalisé de 1,435 mètres, inaccessible à tout véhicule non standard.
Les représentants de la Société de l’Aérotrain, mieux avertis que moi, voyaient bien que la Direction de la SNCF comme les pouvoirs publics étaient très réticents, pas encore convaincus de l’intérêt économique et commercial de la grande vitesse faute d’une expérimentation en grandeur ; tandis que les techniciens de leur coté avaient pu s’en convaincre, mais étaient bien déterminés à faire un TGV, à l’époque dans la version du Turbotrain, et avaient éliminé l’option Aérotrain.
Sur le moment je n’ai pas réalisé que l’étude de l’Aérotrain qui les intéressait était son modèle mathématique technico-économique dans plusieurs versions. Les débats furent passionnés : les représentants de la Société de l’Aérotrain et ceux de la SNCF passaient leur temps à se jeter à la figure des passages de mes rapports techniques, censés représenter l’objectivité selon l’optique de chacun.
Excédé, je finis par me retirer, arrêtant mon étude sans l’avoir terminée. Je n’arrivais pas à obtenir de l’entreprise de génie civil retenue pour construire la voie qu’elle me donne les éléments pour un modèle technico-économique de l’infrastructure : elle n’était pas formatée pour la science de la conception, et ne savait que calculer un devis pour une voie à établir sur un terrain déterminé, supportant une charge dynamique donnée, n’arrivant pas à généraliser. Je n’ai pu faire aucune étude de la pénétration de l’Aérotrain en ville. L’étude des vibrations périodiques et aléatoires engendrées par le passage sur les poteaux successifs et les irrégularités de la voie n’a pu non plus être menée à bien. L’avantage comparatif de légèreté de la voie et de la fréquence élevée dans la formule Aérotrain , autorisant un service nouveau, n’a donc pu être étudié sérieusement dans le modèle.
L’étude économique de la ligne Paris Sud Est par la SNCF fut présentée au Ministére des Transports en mai 1969 et a joué un rôle central dans les options adoptées. Les rapports finaux affirmèrent que le modèle technico-économique du TGV avait été «confronté» à celui de l’Aérotrain : je le crois volontiers, car lorsque les conclusions du modèle du Turbotrain ont été présentées dans une conférence et publiées, on s’est aperçu que le Service de la recherche avait purement et simplement repris les notations mathématiques du modèle du système concurrent : le représentant de la Société de l’Aérotrain qui assistait à la conférence n’a pas manqué de féliciter le conférencier de « ses bonnes lectures ».
L’expérimentation commerciale en vraie grandeur fut opérée à partir de mars 1970 sur la ligne de turbotrain Paris Caen Cherbourg. On s’aperçut alors qu’il y avait du monde dans d’autre trains que ceux de midi et de 18 heures pour la Normandie, ou ceux de 8 heures 47 du matin et du soir avec couchettes pour des destinations plus éloignées, et qu’on avait intérêt à améliorer la qualité de service pour augmenter la demande.
Il fallut ensuite trois ans au Service de la recherche, jusqu’en 1971, pour convaincre sa direction générale, puis l’autorité publique (Pompidou). Donc dès 1971 il était acquis que l’Aérotrain ne serait pas retenu : ni pour Paris Lyon, ni pour aucun trajet interurbain, même pas Paris-Orléans malgré les 18 km construits.
Aujourd’hui il apparaît que la Société de l’Aérotrain aurait dû cesser de s’accrocher à Paris-Lyon, chasse gardée par le Service CO3, et insister sur Orléans ou Grenoble (les jeux olympiques d’hiver, l’avantage de l’Aérotrain pour grimper les côtes), mais à cette époque même Paris-Lyon n’était pas accepté par les Finances, qui ne croyaient pas à la grande vitesse sur terre, et bloquaient tous les projets.
Dès lors l’environnement externe de l’Aérotrain (le « milieu associé » à son infortune) cessait d’être représenté par la SNCF, dont il aurait fallu abandonner le territoire.
Le dossier économique du TGV fut bouclé en octobre 1971, mais pas les choix techniques : de mars 1971 à mars 1974, on opéra ces choix dont les principaux furent la traction électrique, et la modulation de la capacité en fonction de la demande par la fréquence d’un train de composition fixe, et non par le nombre de wagons du train comme sur le réseau existant. La décision définitive d’électrifier fut prise en novembre 1974, non pas à cause de la crise de l’énergie, l’augmentation du prix du pétrole qui aurait rendu plus chère l’exploitation en turbine à gaz, mais parce que la traction électrique coûtait beaucoup moins cher en investissement, préoccupation majeure des Finances au moment de la décision.
En 1975, après l’appel d’offres pour la construction du TGV, la SNCF supprima son Service de la recherche, qui n’avait pas d’autre vocation que le projet C03 : plus besoin de chercher désormais ; on se cantonnait à l’exploitation du TGV, la «recherche» étant limitée à son perfectionnement éventuel.
La décision politique du TGV Paris Lyon fut prise par le président Pompidou avant sa mort en mars 1974 pour 1980, malgré l’hostilité des Finances aussi bien envers le TGV qu’envers l’Aérotrain.
Le nouveau président après s’être fait prier l’entérina ensuite en juillet : il finit par admettre qu’un retour sur investissement honorable pouvait être espéré au vu du bon accueil du public sur la ligne Paris Caen Cherbourg, et il fit en passant quelques économies virtuelles en enterrant l’Aérotrain.
Quelles conclusions en tirer ? De fait, la SNCF recherchait le système optimum de transport soumis à la contrainte de rouler sur des rails : comme elle confinait sa recherche au pied de ce réverbère, elle trouva d’abord le Turbotrain, puis sa version électrique, le TGV actuel, qui coûtait moins cher, fut agréée par le pouvoir avec réticence, mise en service en 1978 et adoptée par le public avec un succès inattendu qu’on attribua à la formule technique choisie, alors que la vitesse, le gain de temps répondait à un besoin, ou peut-être un désir du moment. En fait ce public engendré à l’origine par Air Inter et l’autoroute aurait adopté de la même façon l’Aérotrain, voire n’importe quel moyen de transport à grande vitesse étant-là à-disposition, qui a contribué à créer d’autres activités économiques : il n’a même pas demandé à quoi ça sert. Les medias comme le public, environnements externes (deuxième couche), ne se sont pas davantage questionnés sur la technique, ne se sont demandés par la suite comment ça marche que lorsque le train est tombé en panne, ou a été victime d’un sabotage.
[1] BERGSON H. : L’évolution créatrice, P. U. F.Paris, 1969, pp 9 et 341
Suite => L’aérotrain : L’enterrement

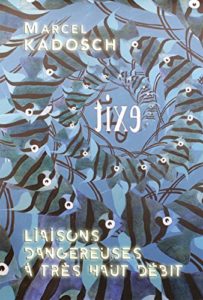
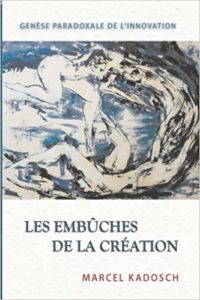

Bientôt cinquante ans plus tard le coussin d’air de Bertin a disparu des transports, tout comme le hovercraft, à part quelques engins militaires pour intervenir en zones de marais.
Il doit bien y avoir une raison!
Parlant plus spécifiquement de l’Aérotrain : après qu’on se soit rendu compte que ni l’hélice ni le réacteur ne seraient tolérés au raz du sol, ceci tant pour des raisons de bruit très fort que de rendement très faible, ne restait que le “moteur linéaire”. Il en existe plusieurs versions, celle envisagée – asynchrone à stator court – impliquait une prise de courant par frotteurs. Comme dans le métro… et assez antinomique du principe de “flottaison sur un coussin” ! Il n’y a d’ailleurs aujourd’hui guère que des “people movers” à l’utiliser, à vitesse relativement faible, celle d’un RER.
Mais tous les moteurs linéaires exigent un maintien d’entrefer bien plus faible que ce que permettaient les tolérances inhérentes au principe du coussin d’air et le débattement qu’elles impliquaient. On aurait donc eu un rendement tout à fait exécrable.
Formulé autrement : il ne servait à rien de calculer la largeur optimale à donner au véhicule, ni, a posteriori, d’accuser la SNCF de torpillage, L’Aérotrain n’aurait pas marché!