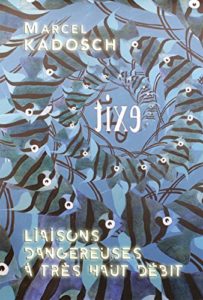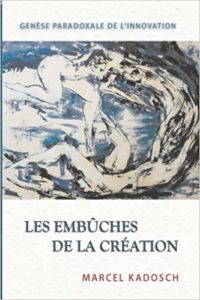L’œuvre d’art a donné lieu à un très grand nombre de commentaires sur son origine dont les détails les plus marquants seront rappelés. Je n’ai pas pu les lire en totalité (ah l’internet des objets, blogs compris !) : mon intention se limite, d’une part à y ajouter quelques détails non mentionnés, d’autre part à rendre hommage au modeste parolier dont un soir tragique de 1940 je me suis rappelé l’humble refrain, titre de ce chapitre, en écoutant un discours péremptoire.
Pourrais-je généraliser à d’autres arts, et si possible à tous, une part au moins de ce qui a été dit de la musique (IC, ch. 17), notamment de son but ? Commençons par explorer cette hypothèse, en substituant au mot «musique» les mots «œuvre d’art» dans le texte cité :
L’œuvre d’art est un moyen de communication puissant, un media qui apporte du plaisir et qui suscite aussi des résonances chez ses spectateurs mais sa conception n’intéresse comme public qu’une partie de l’humanité.
Il existe des œuvres d’art et chacun de nous ne reconnaît que celles qui parlent à sa sensibilité, à son univers : l’œuvre d’art est porteuse de significations virtuelles que chacun active à sa façon, y compris l’artiste.
N’étant pas moi-même artiste je ne peux que tenter d’identifier des illusions créatrices qui ont pu diriger un artiste, d’explorer son environnement interne, et n’être témoin externe que de l’art qui me parle.
Un groupe humain tend à se différencier par une langue, expression de son identité. La bonne santé de cette langue reflète celle de la communauté qui la parle : le plus souvent elle n’est pas écrite, elle est un code par lequel les contes, les remèdes, les recettes, les proverbes, les us et coutumes, les connaissances acquises par ce groupe se transmettent, ou disparaissent avec lui. La parole actualise le code, elle fait passer la langue de son état virtuel de code à une réalité. Elle ne peut naître que de la destinée d’une population : pas d’un esperanto, pas d’un logiciel robotique.
Partant de là, peut-on imaginer un artiste peintre ou sculpteur inspiré par une illusion créatrice ; par des contraintes qu’il s’impose ? Pourrait-on parler de peinture dionysiaque extravertie, faisant jaillir du chaos des formes originelles, violentes, Olympia, Guernica, entrer en transe, se libérer de son moi ? Ou au contraire glorifier une peinture apollinienne introvertie, peindre l’ordre, la sérénité, la contemplation religieuse, ou sinon déclencher des scandales, qui n’ont pas manqué dans ces arts ?
J’ai pu interroger deux musiciens. Je ne connais aucun peintre en activité. Alors qui ? Maître Frenhofer[1], Hitler, un tagueur…
- Origine de l’œuvre d’art
Cet exposé préalable n’est pas contredit en apparence par les propos du philosophe Martin Heidegger, penseur de la modernité et de la technique qui est un mode de dévoilement de l’étant, dont la thèse sur la question de la technique et de ses objets a été mentionnée au chapitre précédent. Son exposé sur l’origine de l’œuvre d’art a été rendu public à partir de 1935. L’environnement externe de ces œuvres d’art à cette époque doit être décrit en tant que tel, en vue d’interpréter les propos du philosophe, qui ont suscité des controverses élargissant le débat à ses thuriféraires, disciples et contradicteurs. Il propose la piste suivante à la fin de son exposé :
«Tout art est essentiellement poème … Tous les arts : architecture, sculpture, musique, doivent être ramenés à la poèsie» qui tient une place essentielle car elle a le pouvoir d’opérer l’éclaircie de l’être. La langue est le lieu du combat entre la réserve de la terre et l’éclaircie du monde : «le monde reposant sur la terre veut la dominer parce qu’il s’ouvre, il ne tolère pas d’occlus ; la terre aspire, en tant que reprise sauvegardante, à faire entrer le monde en elle et à l’y retenir», … «installant un monde et faisant venir la terre, l’œuvre est la bataille où est conquise la venue au jour de l’étant dans sa totalité, c’est à dire la vérité [2]».
La langue, le code qui raconte l’étant ; pas le langage, outil du subjectif qui permet à l’individu d’exprimer ses idées : voilà qui simplifie le problème. La parole : un poème, actualise ce code. Le poème, pris dans son sens grec doit s’entendre ici «création», mise en œuvre de la vérité, son instauration, qui est à la fois inauguration, fondation et don (d’un surcroît de donné)[3]
Tentons d’ «éclaircir» chez Heidegger au fur et à mesure son vocabulaire pour saisir au moins une partie de ses propos.
On traduit par «éclaircie» de l’être, du monde ou de la clairière un mot allemand qui ne signifie pas lumière, mais libération, ouverture. Son sens est proche en français de celui de l’éclaircie forestière, qui consiste à pratiquer une coupe d’arbres pour libérer en les dégageant les arbres vigoureux qu’on garde, favoriser au passage un apport de lumière au sol, la création de clairières, sans pour autant supprimer l’ombre de la forêt, ni même la nuit à son heure : pas de lumière sans l’éclaircie de la clairière, pas d’étant, qui ne peut advenir qu’en pleine lumière dans l’ouvert, dévoilé par l’être, qui demeure voilé dans une réserve. L’être qui attire vers la terre obscure lutte contre l’étant qui va vers l’éclaircie pour oublier la réserve d’où il vient. Cette éclaircie-là étant humaine est un bel exemple d’objet artificiel aux fins multiples. Le poème a le pouvoir de libérer l’être, d’ouvrir le monde.
Le Monde de Heidegger est l’ensemble des étants qui s’offrent à la désignation de la parole, qui sont nommés : il y en a qui sont des ustensiles, des objets artificiels, et d’autres qui font voir l’être : ceux là seuls sont des œuvres d’art à ses yeux.
Heidegger qui n’a pas mentionné là la peinture, tient à ramener ces quelques arts à un seul : le Poème, pour promouvoir la langue ; alors qu’il est fort loin d’avoir énuméré tous les arts, ne serait-ce qu’en se limitant à l’art contemporain de son époque datant de presque un siècle qui avait foisonné en application anticipée de ses concepts, et en ignorant l’explosion plus récente d’œuvres d’art de toutes sortes. Elles ont surgi du renoncement au but antique: la beauté, et de l’utilisation des innombrables outils mis à disposition de l’artiste par la modernité, la science et la technique. Les évoquer nous entraînerait beaucoup trop loin : mettant entre parenthèses la postmodernité, tenons-nous-en à l’univers connu du philosophe en 1931, date de son «tournant», pour répondre à notre question initiale.
Revenons au début de son exposé : voulant trouver l’origine de l’œuvre d’art, il voit que cette œuvre est d’abord une chose.
Si l’œuvre d’art est une chose, pourrait-on demander, où serait-elle alors ? Pas dans le manuscrit de la musique, qui garde le silence. La musique n’existe qu’exécutée. L’œuvre musicale, la danse, un tableau, ne sont pas des choses, mais des événements : en regardant un tableau sans le voir, sans créer un événement, nous percevons la chose, pas l’œuvre d’art.
Après examen, Heidegger reconnaît dans le couple matière-forme la meilleure détermination de la chose à laquelle l’œuvre donne forme ; il décrit aussi bien la chose de la nature que la chose d’usage : la matière renvoie au but assigné, tandis que l’œuvre d’art renvoie à elle-même. L’art est la mise en œuvre de la vérité, par et dans l’œuvre, celle-ci représente l’être des choses. Mais l’étant est toujours le produit d’une fabrication.
Quel objet est donc une œuvre d’art ? serait-il un objet artificiel ? Heidegger distingue la chose de l’œuvre, et place entre les deux le produit qui n’est ni la chose ni l’œuvre. La chose simple est un être-à-portée-de-la-main, qui apparaît dans son manque-à-disposition. Il y a un artisan, qui produit en vue de l’usage, et un artiste, qui agit pour faire advenir la vérité, telle que le philosophe la conçoit (chapitre 2. 5). Heidegger assigne à l’œuvre la fonction de dévoiler la vérité, mais veut identifier son origine et non sa destination, son but : elle offre les conditions qui permettent à la vérité d’advenir. L’œuvre ne réalise pas un but : elle contient la vérité du produit, son être, elle l’abrite, de telle sorte que la vérité est un phénomène qui advient, qui surgit du coté de celui qui la contemple, qui écoute la musique, qui regarde le tableau, la statue, qui entend le poème : ce qu’il dit et ce qu’il ne dit pas, dans le silence entre les mots. Soit, POSIWID : le but de l’œuvre est alors ce qu’elle fait, ici faire en sorte que la vérité puisse advenir. L’origine dévoilée est devenue le but.
Mais Heidegger pense l’être, pas l’œuvre d’art, et rejette cette vue comme trop subjective. Il y a bien un artiste, qui agit pour produire la vérité, mais le génie de l’artiste n’existe pas, il n’est que le «berger» de l’être. Par rapport à l’œuvre l’artiste est comme un catalyseur, dont la trace du passage disparaît lors de la création. La vérité advient dans l’oeuvre d’art par la pensée, la vérité est un événement qui surgit hors de son retrait (a-léthéia) elle n’est pas la vérité adéquation produite par la science, qui est l’exploitation d’une région du vrai déjà ouverte, la domination de cette « éclaircie » où la vérité rayonne ; et ce ne serait pas n’importe quelle science, pas celle qui prône la destruction de la terre originaire, la fission nucléaire ; certainement pas l’agriculture motorisée qui a envahi la réserve de la terre, les tracteurs qui passent dans les sillons du laboureur.
Choisissons quelques exemples dans les pratiques de l’art moderne, qui ont pu inspirer ces concepts plutôt qu’être inspirées par eux car ils n’ont été exprimés qu’à partir de 1931 :
La beauté, but antique, est vue comme un simple mode d’ouverture de la vérité, mais l’art en est venu à répudier ce but. Andy Warhol met en œuvre et dévoile par sa démarche une vérité : les lois du marché, de la publicité, de la communication, la répétition du produit. L’art est ramené au produit ; l’artiste et son œuvre, le créateur et l’objet artificiel en apparence ne font qu’un, mais où est le but, sinon dans la mise en œuvre de ce produit ?
N’importe quel objet fabriqué peut être élevé à la dignité d’œuvre d’art, simplement en étant désigné comme tel : c’est la démarche du ready made inaugurée par Marcel Duchamp, par exemple en signant un urinoir comme œuvre d’art sous le nom : «Fontaine».
Débarrassons l’art de toute intention : aucun but, l’œuvre d’art ne répond pas à la définition de l’objet artificiel, il est autoréférentiel . Magritte peint un tableau sans autre signification que ce qu’il donne à voir : «Ceci n’est pas une pipe». En effet : ceci est un tableau. Kossuth expose cinq mots en néon orange sous le titre : «Five words in orange neon». Il présente côte à côte : une chaise, sa photo, et la définition d’une chaise recopiée d’un dictionnaire. John Cage compose : «4’33’’», un morceau composé de trois mouvements, joué en silence par un pianiste pendant quatre minutes trente trois secondes : ce qu’il donne à entendre c’est l’écoute des bruits dans la salle de concert, qui font du silence une véritable musique.
Autre concept originaire érigé en but : l’installation, l’intégration de l’œuvre dans un lieu : exposition, musée, collection ; la mise en situation de techniques d’expression et de représentation avec une participation du spectateur modifie le rapport entre l’œuvre et son public. L’œuvre est définie, pensée, en fonction du lieu qu’elle occupe, l’œuvre-lieu installe un monde. L’installation est une ouverture du monde. Mais elle-même n’est pas de l’art.
Dirons-nous qu’une œuvre est une interface entre un environnement interne : dévoiler la vérité (abritée dans une boite noire : la terre), et un environnement externe, dont l’installation : le monde, est un exemple ? L’artiste Kaprow parle d’ «environnement» pour qualifier ses productions, telles que le happening, intégrant à l’œuvre des installations comme des mises en situation du spectateur, présentées sous le nom générique d’art performance qui couvre un grand nombre de nouveautés contemporaines de Heidegger : dada, surréalisme, futurisme, Bauhaus, et de plus récentes comme le body art, le situationnisme ; le temps, l’espace, le corps sont ses outils de base. L’intention générale, s’il en est une qu’on peut appeler but, semble être d’infiltrer l’environnement externe, de l’impliquer, au lieu que l’artiste seul conçoive et crée un objet artificiel pour un but humain déterminé auquel il le confronte.
On pourrait y retrouver la création collective d’une religion par une foule en passant par un meurtre collectif (IC, ch. 13. 3), le rôle du créateur étant tenu par le modèle médiateur d’un désir initial transformé en violence. Les rituels qui s’ensuivent sont l’origine lointaine de l’art performance.
Ces tendances vont aussi dans le sens du souci qui pousse Heidegger à ignorer la subjectivité, à s’en détourner, à dénoncer une pensée occidentale dit-il, qui oublie l’être, dont la parole poètique est seule à pouvoir dire le sens. Elle ne connaît plus que l’étant : celui de Platon et de Descartes, où l’esprit se tourne vers le monde et les choses en relation avec les fins qu’il s’est assigné à lui-même, toute chose devenant ce que nous avons nommé un objet artificiel, et que Heidegger appelle l’être-à-portée-de-la-main ; où l’esprit se détourne de la contemplation du monde, et des choses. En mettant de la raison dans le Rhin sommé de produire de l’électricité en passant à travers des turbines, on instrumentalise le fleuve, et on dissimule l’apparition de son être, son éclosion phénoménale, éclairée par le poème de Hölderlin : Le Rhin .
Toute chose serait devenue un outil. Pourtant chaque chose est, et cet être confère à l’étant un sens, avant qu’il ne soit dissimulé par les attributs définissant l’étant. L’art est apparu pour remplir la fonction d’éclairer l’étant par la clarté originaire de l’être, qui est l’événement à la fois d’une manifestation et d’une dissimulation. L’être se retire pour préserver l’événement de son apparition : la lumière crue aveugle. Heidegger évoque l’image de la clairière assiégée par l’ombre de la forêt : l’obscure clarté qui en émane prépare l’éclaircie de la clairiére.
Le chercheur qui explore le pied d’un réverbère dont c’est la lumière, plutôt que celui d’un phare où l’on ne voit rien parce qu’il aveugle l’horizon lointain, éprouve un sentiment semblable s’il y distingue les contours d’une révélation encore obscure. «En allumant un réverbère on fait naître une étoile de plus, en l’éteignant on endort l’étoile», dit le Petit Prince. L’art allumeur de réverbères éclairant l’œuvre d’art, seule capable de dévoiler ? «Il s’occupe d’autre chose que de lui-même. [4]» Mais le chercheur, lui, est resté dans la subjectivité.
Avant d’aborder les exemples d’application de ces vues à l’œuvre d’art, exprimons un certain malaise à propos des images évoquées par le philosophe dans sa quête de l’être, illustrée par des descriptions poètiques.
L’éclaircie de la clairière et l’ombre de la forêt sont peut-être, dans le « langage » ordinaire, des phénomènes de la nature, mais en aucun cas le champ labouré, le sillon, quel que soit l’ustensile, motorisé ou non, utilisé : ni plus ni moins que la rue pavée des villes. Il faut de moins en moins de terre pour faire pousser un grain, même pas de sillon, le toit d’un gratte-ciel, les terrains vagues de la ville peuvent suffire.
Le champ cultivé, comme le toit du gratte-ciel depuis peu, est un objet artificiel, un être-à-portée-de-la-main, une matière mise dans une forme, une chose qui apparaît dans son manque-à-disposition : la rue aussi.
- Des godasses
Venons-en aux exemples que le philosophe présente à l’appui de sa thèse dans le texte : «L’origine de l’œuvre d’art[1]», qui reproduit une conférence donnée en novembre 1936, publié en 1949 au début d’un recueil intitulé : «Chemins de bois (de bûcheron)», traduit improprement par : «Chemins qui ne mènent nulle part». Le chemin tracé du bucheron mène quelque part : à une clairière, un fourré, une forme de but, mais le promeneur ne sait pas où il mène ; le but est dissimulé. Un chemin mène toujours quelque part : on ne sait pas où mènera celui qu’on crée à coup de machette dans la jungle, mais il sera son but. POSIWID : l’origine contient la vérité dissimulée du but, qu’elle dévoile. Même une impasse mène quelque part : à l’entrée du chemin emprunté. Voyons les exemples.
Un temple grec s’élève dans le paysage dont il dévoile le caractère sacré. L ‘environnement du temple est ce que le philosophe nomme : la terre, le ciel, les divins et les mortels. Le temple est sanctifié par la statue du dieu qu’il contient et l’espace sacré qui le limite. Il ouvre un monde qui s’appuie sur lui, et repose sur un rocher qui l’enracine dans ce que le philosophe a nommé la terre. Mais l’environnement d’un temple grec est aussi le ciel pur de la Grèce et sa lumière : on n’ira pas le visiter un jour de pluie.
Un exemple plus significatif a été présenté auparavant : c’est une méditation sur un des nombreux tableaux où Vincent van Gogh a peint de vieux souliers. On n’en sait rien par Van Gogh lui-même, sauf le titre par lequel le tableau est désigné : «Vieux souliers aux lacets». Cela semble être le nom d’un plat nommé dans un menu : «bifteck aux spaghetti», qui évoque la figure de Charlot dont les souliers ont été magnifiés en œuvre d’art dans le film : «La ruée vers l’or». Ils y sont transcendés en un repas pour vagabond affamé : les semelles mangées comme des biftecks avec une garniture de lacets engloutis comme des spaghetti, en suçant les clous comme des osselets. Mais Van Gogh n’a pas connu Charlot, ni ce film, ni le cinéma.
Heidegger voulant expérimenter ce qu’est en vérité le produit, qu’il a placé entre la chose et l’œuvre, prend comme exemple «une paire de souliers de paysan[2]». Ensuite il déclare qu’à titre d’illustration il «choisit un célèbre tableau de Van Gogh», dont il a dit précédemment (la succession des dires est significative) qu’il «représente une paire de chaussures de paysan» et «voyage d’exposition en exposition [3]» : donc un produit. Il enchaîne : «l’être-produit du produit réside en son utilité … le produit sert à la paysanne aux champs qui porte les souliers». Le paysan est devenu paysanne, passons. Mais «tant que nous nous contenterons de regarder sur un tableau de simples souliers vides qui sont là sans être utilisés, nous n’apprendrons jamais ce qu’est en vérité l’être-produit du produit[4]… Autour de cette paire de souliers de paysan il n’y a rien où ils puissent prendre place…même pas une motte de terre, une paire de souliers de paysan et rien de plus. Et pourtant…»
Et pourtant, Heidegger entonne soudain un péan célébrant la paysanne :
« … Dans l’obscure intimité du creux de la chaussure est inscrite la fatigue des pas du labeur. Dans la rude et solide pesanteur du soulier est affermie la lente et opiniâtre foulée à travers champs, le long des sillons toujours semblables, s’étendant au loin sous la bise. Le cuir est marqué par la terre grasse et humide… À travers ces chaussures passe l’appel silencieux de la terre, son don tacite du grain mûrissant, son secret refus d’elle même dans l’aride jachère du champ hivernal. À travers ce produit repasse la muette inquiétude pour la sûreté du pain, la joie silencieuse de survivre à nouveau au besoin, l’angoisse de la naissance imminente, le frémissement sous la mort qui menace. Ce produit appartient à la terre et il est à l’abri dans le monde de la paysanne. Au sein de cette appartenance protégée, le produit repose en lui-même… en sa disponibilité. C’est elle qui nous révèle ce qu’est en vérité le produit[5]».
Nous appelons vérité un jugement qui l’oppose à la fausseté, à l’erreur. Le philosophe l’appelle dans le sens du mot grec a-lethéia, qui l’oppose à l’oubli, au caché : sa vérité est un dévoilement, une révélation, un rappel. Il y a quelque chose plutôt que rien, qui était dissimulé dans la boite noire figurant la terre : peut-être son «appel silencieux», ou pour un autre «ce qu’on croit dans la tombe et qui sort, ce qui renaît quand un monde est détruit»[6]: l’être-produit du produit, ce que l’œuvre fait, qui opère l’éclaircie de l’être, la mise en lumière, c’est «la poèsie ardente» ; ce qu’elle convoque, un autre l’a appelé : «l’aurore».
Jusqu’à présent il n’a pas été question d’art : ce qu’est en vérité l’être-produit du produit réside en son utilité, qui est sa disponibilté pour la paysanne : un fonctionnement digne de confiance. L’être-produit du produit réside alors dans le but dévoilé de l’œuvre, quelle qu’ait été son origine, celle de l’artisan, qui est ce que l’œuvre fait en réalité, ici selon l’auteur faire en sorte que la vérité puisse advenir : un combat entre l’éclaircie de l’être et sa réserve. Les chaussures du tableau font voir l’être et c’est par là qu’elles sont des œuvres d’art.
Mais l’être-produit du produit qui réside dans son utilité, sa disponibilité s’il s’agit des souliers du tableau illustrant ceux du paysan-paysanne, a disparu par l’usage prolongé, les lacets défaits en témoignent. Souliers pour souliers, Heidegger eut été mieux inspiré de parler de sabots et de méditer sur ceux de l’angelus de Millet ou de ses glaneuses : son commentaire pathétique n’aurait soulevé aucune interrogation. Comparant au contraire ce que moi-même et mes semblables voyons dans le tableau de Van Gogh à ce que ce philosophe déclare y avoir vu, je ne peux m’empêcher de penser à ce que le savetier d’Apelle avait vu dans son tableau, selon Pline l’Ancien : «Pas plus haut que la chaussure !» lui avait ordonné cet autre grand peintre. Qu’aurait dit Van Gogh au philosophe, nous ne le saurons pas : il a souvent peint des vieux souliers mais n’a pas dit pourquoi. Il n’a pas écrit : «Ceci n’est pas des vieux souliers», sous-entendant : «Ceci est un tableau».
Nonobstant Apelle, le soulier est un étant en relation avec d’autres par son usage : le pied, les lacets, la marche, le chemin, mais justement pas dans la vision de ce tableau de Van Gogh ; on ne sait pas d’où il vient, sorti de quel pied, où il va, on est tenté d’y voir une œuvre d’art autoréférentielle, sans signification ni but. Mais dans la vision du produit par Heidegger : des vieilles chaussures champêtres, l’œuvre contient la vérité du produit, son être-produit, ces chaussures enracinées dans la «terre» sont sanctifiées par les pas du labeur qu’elles ont contenus, elles révèlent la terre de sillons labourés en boustrophédon avant l’arrivée du tracteur. L’œuvre d’art fait éclore l’être de l’étant, ce qui fait éclore un horizon, ouvrir au monde de la paysanne, qu’elle révèle.
L’ennui c’est que Van Gogh a pris la peine de dire un jour à son ami Gauguin, qui l’a rapporté, ce qu’il ressentait en peignant ce genre de tableau, et quelles godasses il peignait : en aucune manière celles d’un paysan devenu paysanne par fécondation dans le ventre de la terre originaire, mais d’après Gauguin celles de Van Gogh lui-même qu’il a portées dans sa jeunesse pour aller à l’étranger (la Belgique) prêcher l’évangile dans les usines. Elles ont supporté les fatigues du long voyage d’un pélerin. L’œuvre d’art «choisie» comme illustration par le philosophe a donc de fortes chances de ne pas être une clarté matinale de l’être dans la campagne, mais la souffrance de l’artiste en errance en milieu ouvrier. Obsédé par l’être, Heidegger voit les choses autrement :
«L’être-produit du produit a été trouvé. … Nous n’avons rien fait que nous mettre en présence du tableau de Van Gogh. C’est lui qui a parlé …l’œuvre d’art nous a fait savoir ce qu’est en vérité la paire de souliers. Ce serait la pire des illusions que de croire que c’est notre description, en tant qu’activité subjective, qui a tout dépeint ainsi pour l’introduire dans le tableau. Avant tout, l’œuvre n’a nullement servi comme il pourrait sembler d’abord, à mieux illustrer ce qu’est un produit. C’est bien plus l’être-produit du produit qui arrive, seulement par l’œuvre et seulement dans l’œuvre à son paraître[7]»
«Ce paraître de l’être-produit n’aurait pas lieu dans un ailleurs que l’œuvre d’art pourrait illustrer en y renvoyant, il a lieu, proprement et seulement en elle, dans sa vérité même », commente Jacques Derrida, appelé au débat ; «ce n’est pas en tant que chaussures-de-paysan, mais en tant que produit ou en tant que chaussures comme produit que l’être-produit s’est manifesté[8]»
- Oeuvre ou produit ?
Heidegger choisit un célèbre tableau, pour illustrer un produit, en tant que produit et non en tant que tableau, l’appartenance à un monde et à la terre. Mais alors pourquoi avoir choisi une peinture ? demande Derrida . Pourquoi pas directement la chaussure-de-paysan ? De quoi s’agit-il au moment où intervient la prétendue illustration : l’interprétation de la chose comme matière mise dans une forme domine la théorie esthétique de l’art ; ne serait-ce pas à partir de la chose comme œuvre ou comme produit que ce concept se serait constitué ?
Selon Heidegger, le produit (chaussures) a sa place intermédiaire entre la chose et l’œuvre (tableau), bien que l’œuvre ressemble davantage à la chose pure et simple ne renvoyant qu’à soi : le noyau placé dessous. Selon Derrida, chacun de ces trois modes d’être passe au dedans puis au dehors de l’autre : comme un lacet passant et repassant dans l’œillet de la chose : de dedans au dehors et inversement, sur la surface externe et sous la surface interne (hypokeimenon) et vice versa, de sorte que l’oeuvre peut être vue aussi comme un produit.
Fort bien, mais avant de «choisir» un tableau, «au cours de cette interrogation sur le produit comme matière informée, l’exemple de la paire de chaussures survient dans le texte au moins trois fois avant et sans la moindre référence à une œuvre d’art, qu’elle soit picturale ou autre», en même temps qu’une cruche, qu’une hache, donc comme produit réel. «En tous les cas, cet exemple se passe très bien pendant de longues pages de toute référence esthétique ou picturale[9]».
Faute d’avoir trouvé un témoignage irrécusable de Van Gogh lui-même déclarant d’où viennent les chaussures du tableau et «ce qu’est en vérité la paire de souliers», on pourrait penser à la fin du film : Le Faucon Maltais, où un flic demande quelle est la matière de la statuette d’oiseau que les protagonistes viennent de casser, et où Humphrey Bogart lui répond en citant Shakespeare : c’est encore bien mieux des godillots du tableau et de «ce qu’ils sont en vérité» pour Heidegger, puis pour ses nombreux contradicteurs, qu’on pourra dire comme le magicien Prospero qu’ils sont «de la matière dont les rêves sont faits » : une illusion collective créatrice de visions de tous ceux qui ont regardé le tableau, chacun à sa façon, l’illusion de Heidegger lui-même étant d’avoir cru voir s’introduire «la pire des illusions» précisément. Exemple saisissant d’illusion créatrice du poème de l’être, de la terre, de son appel silencieux, du «combat entre la réserve de la terre et l’éclaircie du monde», faisant suite à l’illusion créatrice d’une activité supposée introduite sous le pinceau du peintre, l’enracinement des souliers dans la glèbe : à croire que la subjectivité évidente de Van Gogh a engendré chez Heidegger, s’il est sincère, une hallucination subjective, fantasmatique, inconsciente, correspondant à ses croyances. Mais en 1936 a-t-il vraiment été sincère ?
Un débat curieux s’est élevé à propos de la conférence de Heidegger sur l’origine de l’art prononcée en novembre 1936. Il en est résulté à terme une controverse interminable, qui perdure, opposant un grand nombre de personnages réputés sérieux, dont les propos sont rapportés dans l’Internet des objets : ils ont donné lieu à une conférence à NewYork en 1977, un polylogue du philosophe Jacques Derrida suivi d’un débat, qui a même été reproduit dans une pièce de théâtre jouée à Genevilliers en 2013 ; on peut aussi trouver dans Internet une autre pièce de théatre fictive racontant cette histoire, déjà lue à Valence en 1993[10]. L’affaire se présente donc avec la structure temporelle d’un récit et mérite d’être présentée d’abord sous cette forme.
ACTE I : Heidegger, Sujet désirant ne lui déplaise, tente d’atteindre un objectif : concevoir et retrouver l’origine de l’œuvre d’art, au bénéfice d’un Destinataire : l’ensemble de ses disciples et auditeurs, et si possible de membres du parti nazi dans leur disposition d’esprit en 1936 ; but et utilisateurs qui lui sont proposés par des Médiateurs qui lui ont désigné l’objectif, et l’on mis en mouvement dès 1931, savoir : un «tournant» opéré sur son œuvre précédente Etre et Temps, puis son adhésion au parti nazi . Le Sujet rencontre sur son chemin des Opposants : incompréhension de son discours par les nouveaux dirigeants, incompréhension de l’art par les nazis, l’empêchant de prendre ses exemples dans l’art moderne, dont on n’a aucune raison de penser qu’il le rejetait ; il accomplit l’action à l’aide d’Adjuvants : des souliers de paysan, et introduction en contrebande d’un artiste moderne, Van Gogh, en contournant les obstacles culturels créés par le pouvoir en place à l’aide d’un être-produit de produit.
ACTE II : La publication de la conférence après la guerre en 1949 provoque de nouveaux Opposants : des experts en peinture, auxquels répondent d’autres Adjuvants : les disciples et thuriféraires du philosophe ; et d’autres Sujets, qui écrivent la suite du récit.
Heidegger a dit lui-même qu’il «choisit un célèbre tableau de Van Gogh qui a souvent peint de telles chaussures» : un tableau montrant «une paire de souliers». Faute de mieux, je choisis de rapporter l’histoire dans l’ordre chronologique, ce qui a pour effet de suggérer une autre version des faits ; mais d’un bout à l’autre de cette affaire, la possibilité demeure que la raison : post hoc ergo propter hoc égare le jugement vers la création de pistes illusoires.
PROLOGUE 1880 : Van Gogh est un peintre célèbre qui a été inspiré par ses contemporains et a inspiré à son tour l’expressionnisme. Il a peint plus de deux mille toiles, dont il parle dans de nombreuses lettres écrites à sa famille, mais il n’y parle pas de la douzaine de tableaux où il a peint des souliers. Certes il a beaucoup peint les champs, et la foulée à travers champs de paysans et de paysannes, ainsi que des scènes et portraits de ce monde paysan comme «les mangeurs de pommes de terre». Au surplus il a écrit : «Je suis un peintre de paysans…c’est là que je me sens dans mon milieu». Mais il a peint aussi souvent des scènes et des personnages du monde de la ville, d’où le débat : qui est le propriétaire de ces souliers, dont l’identité met en cause la vérité dévoilée par l’art.
ACTE I : 1931 : au «tournant», Heidegger écrit l’origine de l’art , première version non publiée : pas de Van Gogh, seulement un temple grec.
1933 : il se retrouve dans la «pensée» nazie, identifiée par erreur à la sienne, puis déchante, les nazis ne le comprenant pas. Cette même année un expert en peinture nommé Goldstein est expulsé d’Allemagne et trouve refuge via Amsterdam aux États Unis, où il devient professeur à l’Université Columbia de New York.
1935 : Heidegger reprend la première version, donne une conférence mais toujours pas de Van Gogh.
Novembre 1936 : Van Gogh apparaît enfin dans une deuxieme conférence. Heidegger repère «le produit en vérité : un soulier de paysan», choisit un célèbre tableau de Van Gogh comme illustration de ce produit, ne parle pas du contenu culturel, mais des images évoquées, qu’il prétend à l’origine de l’œuvre, dans des termes somme toute acceptables par le parti. Il n’est pas impossible que Van Gogh ait été introduit en douce, dans un climat délétère. Les nazis agréeront le temple grec, conforme à l’art allemand, mais ils détestent Van Gogh, son expressionisme : Heidegger lui reproche son subjectivisme, mais il ne voit ici ni l’un ni l’autre. Dans l’optique nazie les souliers vieux et laids sont des godasses bonnes à jeter, rien d’autre, en aucune façon une œuvre d’art, sinon dégénéré. Mais Heidegger dit que Van Gogh peint leur intérieur où il prétend voir un champ. Heidegger se sent profondément paysan, il est à son aise dans ses chaussures.
En 1936 Hitler était au sommet de sa gloire civile, accepté et admiré par beaucoup, aveugles à sa brutalité ; le redressement spectaculaire de l’Allemagne impressionnait, les méfaits du nazisme encore sous-estimés, voire méconnus, et on pensait que c’était peut-être temporaire : on attendait de voir comment les choses allaient évoluer en évitant de se compromettre. Devant les exactions la réaction populaire était : est-ce que le Fuhrer est au courant ? On a connu ça en France aussi. Mais Heidegger était plutot à l’abri avec sa carte du parti.
Juillet 1937 : La propagande nazie a organisé à Munich une grande exposition présentant face à face : l’art dégénéré (Entartete Kunst), 650 œuvres des plus grands artistes de l’art moderne, entourées sur les murs de commentaires injurieux, qui ont été ensuite vendues ou brûlées ; et l’art allemand vantant la famille (blonde aux yeux bleus, nombreuse), le travail des champs et des usines, le corps athlétique en style néo-classique, et le combat. Deux millions de visiteurs furent attirés, la plupart par l’exposition de l’art dégénéré si l’on en juge par la longueur des files d’attente.
Le décrochage des cimaises des musées des œuvres d’avant garde ou au moins son annonce, et «l’installation» spéciale qui a dû prendre «un certain temps», ont dû avoir lieu au moment où Heidegger a prononcé en novembre 1936 sa nouvelle conférence sur l’origine des arts, où «après» avoir mis l’accent sur la chaussure de paysan, il a «choisi» de l’illustrer par un «célèbre tableau de Van Gogh» : «recours justifié d’abord par une question sur l’être-produit et non sur l’œuvre d’art. C’est comme en passant et après coup qu’on semblera parler de l’œuvre en tant que telle. Au point où Heidegger propose de se tourner vers le tableau il ne s’intéresse donc pas à l’œuvre, seulement à l’être-produit dont les chaussures –n’importe lesquelles– fournissent un exemple[11]». Il dit que les tableaux de ce peintre, gardien de leur être, sont des œuvres d’art, mais trouve le moyen de n’y voir que l’être-produit du produit : à l’intérieur de vieilles chaussures usées. Quelle signification donner à ce non-dit ? L’opposition ouverte étant suicidaire à partir de la nuit des longs couteaux, l’allusion profil bas était une nécessité. Heidegger qui n’était pas un opposant n’est pas allé plus loin. Son propos était de placer une vérité dévoilement face à la vérité adéquation bénéficiant du prestige de la science. En matière de vérité, le pouvoir en place qui opposait une science aryenne à la science juive, un art allemand à l’art dégénéré, aurait condamné la vérité de tout dévoilement non conforme.
J’ignore la contre-indication philosophique (je ne vois pas d’autre source) en vertu de laquelle on n’a pas retenu ce scénario hypothétique. Le témoignage de H. G. Gadamer ne le dément pas, et il a certainement dû venir à l’esprit de quelques intervenants : au moins Jacques Derrida, qui a connu et subi le climat de Vichy, de la Révolution Nationale et des nazis français sous occupation allemande ; mais il a préféré développer un long discours pour tout déconstruire : le tableau, le texte de Heidegger et celui des autres intervenants ; tout sauf Hitler, son fantôme.
ACTE II : 1945. Dénazification. Sous Hitler, en dehors des victimes, il y a eu en Allemagne quelques opposants et retournements de vestes finaux, beaucoup de silencieux terrorisés, mais les nazis ont commis des crimes tellement abominables qu’on a du mal à imaginer l’existence de nazis «modérés». Pourtant le tribunal de Nuremberg n’a pas condamné à mort tous les accusés, il a décélé des nuances. On a admis l’existence de mitlaufer, de suiveurs, où l’on a classé Heidegger. Concernant notre sujet, l’art moderne vilipendé était réellement exécré par le peintre Hitler, mais en marge de leur action publique, voire en cachette, on peut noter que Goering a «acquis» (bien mal) des tableaux de Van Gogh ; et Hiltler lui- même préférait La Veuve Joyeuse de Franz Lehar aux Walkyries de Wagner mais se gardait de le dire.«L’origine de l’œuvre d’art» est publiée à Francfort :
1949: Goldstein situe l’œuvre de Van Gogh évoquée à une époque où Van Gogh habitait à Paris, conteste son interprétation paysanne, fait part de ses doutes à son collègue à Columbia, l’expert américain Meyer Schapiro. Il meurt en 1965. Interrogé en 1965 par Meyer Schapiro, Heidegger lui dit avoir a vu ce tableau dans un musée d’Amsterdam en 1930 : c’est le tableau intitulé : «Vieux souliers aux lacets».
1968 : Meyer Schapiro produit une enquête d’expert, dont le style terre-à-terre contraste avec le lyrisme du philosophe[12]. La conclusion de son enquête est que Van Gogh a peint ses propres souliers alors qu’il habitait en ville, qu’il faut retenir le témoignage de Gauguin qui est le plus crédible, que la paysannerie ne fait rien à l’affaire. Il publie son enquête en hommage à Goldstein.
ACTE III. : 1977. Arbitrage. Le philosophe Jacques Derrida, disciple et thuriféraire de Heidegger, est appelé à donner une conférence à New York en présence de Schapiro, à propos de laquelle il publie à la fin de son livre La vérité en peinture publié en 1978 ce qu’il appelle un «polylogue à n+1 voix- féminine», apparemment une reconstitution du débat entre n intervenants en présence d’une femme organisatrice.
Derrida intervient d’une manière qui n’est pas sans rappeler le maître de philosophie du Bourgeois Gentilhomme. Il consacre pas moins de 150 pages à déconstruire le débat en noyant le poisson dans un fatras de détails. Essayons de ne rapporter que ce qui a trait à des illusions créatrices d’interprétations du tableau.
Derrida fait de son mieux pour apparaître comme un juge impartial renvoyant dos à dos des plaideurs qui rappellent aussi les Plaideurs de Racine, par la minceur de la cause qu’ils défendent : l’interprétation de Heidegger est peu défendable, le juge avocat de son maitre s’en sort en fragilisant celle de son contradicteur, qu’on peut contester aussi. L’origine de l’œuvre d’art est un sujet qui mérite l’attention, mais des propos tenus négligemment à propos d’un tableau de Van Gogh, mis en cause par deux experts en peinture, méritaient-ils que Derrida ait consacré un pavé de cette taille à la défense de son modèle, étendue à des considérations prolixes en très grande partie hors sujet de controverse…
Ainsi il s’étend longuement sur les lacets des souliers qu’il évoque sous diverses formes dont celle de chèques au porteur d’obligation de vérité (?) tirés sur deux sociétés à responsabilité limitée: une SARL Heidegger paysanne et une SARL Schapiro citadine. Des chèques barrés de deux traits séparant une chaussure de l’autre, ou figurant le cadre du tableau, qui le coupent de l’extérieur comme une boite noire[13]. Derrida récidivait : cette même année 1977 il avait publié tout un livre de 300 pages intitulé : Limited inc, a,b,c… à propos d’une SARL imaginée[14] sur un sujet encore plus futile. Alors que Schapiro comme Heidegger sont d’accord pour voir dans le tableau une paire de souliers : de Van Gogh lui-même pour le premier, de la paysanne pour le second, Derrida voit deux souliers du même pied : donc d’aucun sujet. Il revient à la démarche heideggerienne sur la chose et l’oeuvre, et le concept de chose qui lui est tombé dessus en insultant ce qui est chose dans la chose . En traduisant hypokeimenon par sujet, on a fait disparaître de ce sujet ce qui est dessous, le sol qui vient à manquer, le noyau de la chose. Le chemin de la pensée doit s’accorder «avec ce « sujet » en son lieu propre, avec son paysage, sa paysannerie, son monde, et cette chose qui n’est ni du sol ni du paysan mais entre eux, les chaussures». Et de qualifier en conséquence l’attribution des chaussures du tableau à un «sujet» : le paysan, ou Van Gogh lui-même, de «naïve, primesautière et précritique[15]». Devant la description pathétique de la paysanne par Heidegger, alors qu’on méditait sur l’origine de l’art, sur la vérité dévoilement, Derrida, ou l’un des n acteurs du polylogue, pouffe de rire : la chute de tension est trop forte, il croit se retrouver en pleine visite organisée de touristes qui descendent du car, dont il donne une description truculente ; il reprend toute la conférence de l’origine de l’art sur le mode du discours tenu par un guide local souabe, avec projections, sans oublier le japonais qui pose des questions en aparte. Il reproche au passage à Heidegger comme à Shapiro leur sérieux professoral : pourquoi n’ont ils pas déconstruit pour détendre l’atmosphère. On est à mille lieues du scénario sous croix gammée imaginé plus haut.
C’est peut-être faire preuve à nouveau de subjectivité que d’adopter une vision attribuée au peintre, qui dirait que ces chaussures sont celles d’un vagabond, émigré, solitaire, qui a fui sa terre natale et qui erre dans une grande ville : d’un nomade, et non celles d’un paysan- paysanne, attaché à la sainteté du travail de «la terre qui ne ment pas» : du moins le prétend-il-elle en tenant le langage-langue de Heidegger.
On se souvient de la parole qui l’a activé, écrite sur commande par le juif pacifiste Emmanuel Berl, prononcée à la radio le 25 juin 1940 par Pétain à l’adresse du peuple français : ― «Ce n’est pas moi qui vous bernerai par des paroles trompeuses. Je hais les mensonges qui nous ont fait tant de mal : la terre, elle, ne ment pas. Elle est votre recours, …Une jachère à nouveau emblavée, c’est une portion de la France qui renaît…» À nouveau la jachère : le bon apôtre. Par cette adresse, Pétain annonçait la signature d’un armistice : il stipulait le versement de quatre cent millions de francs par jour aux autorités allemandes, somme avec laquelle elles achetèrent entre autres une grande partie de la production de cette terre qui ne ment pas, jachères comprises, ne laissant aux français en liberté que des rutabagas menteurs, les bons et vrais produits que les paysans parvenaient à dissimuler, et ceux qu’on pouvait se procurer au marché noir avec de l’argent là où il en restait encore.
Selon que les souliers sont les sabots de la paysanne enracinés dans la terre, ou les godasses de l’émigré qui arpente le macadam de la ville, l’art dit la relation à la terre, ou au contraire l’exil de l’homme apatride : n’y aurait-il pas un enracinement entre les pavés d’une banlieue, où les grands voyages finissent au bout de la rue ? L’art ne révèle alors aucun être local, mais donne un sens à l’errance sans patrie en révélant à l’homme la souffrance de sa marche vers une terre promise toujours refusée : au lieu de l’enracinement, un déracinement imposé, la course vers un autre destin.
Les chaussures de Van Gogh nous font ressouvenir des émigrations, des expulsions, qui ont jalonné l’histoire. Elles nous conduisent à des paysages urbains désolés, à des rues sans nom. Elles ont oublié les chemins de campagne ou de forêt qui «s’arrêtent soudain dans le non frayé».
En recherchant la vérité dans deux visions opposées d’une paire de vieilles chaussures, c’est d’abord l’économie plutôt que l’art qu’on a rencontré, qui a révélé leur être-produit.
On a opposé le sédentaire agriculteur, Caïn, au nomade berger, Abel, qui se disputent le même territoire ; ou le paysan au marin, quand on voulait opposer aussi les territoires.
Le sédentaire agriculteur est introverti comme les crustacés : il se défend contre le hasard en s’enfermant dans son terrain. Il y édifie des structures à loisir hors du temps et privilégie les biens fonciers: le sédentaire agriculteur est un être des stocks. La terre est un stock. Mais le voyageur qui le réapprovisionne de produits identiques gère lui aussi un flux stationnaire comme un stock, et recommence sans cesse le même voyage.
Le vrai nomade, berger ou marin, est un être des flux qui fluctuent avec une composante aléatoire : extraverti comme les vertébrés, être des lointains, il vit dans un système ouvert à tous les vents, qu’il scrute en permanence pour s’auto-régler ; il a besoin de biens liquides mis à disposition à tout moment. Le monde est un flux changeant.
Le paysan être des stocks dont l’art révèle la vérité à travers ses chaussures figure assez bien le modèle médiateur attaché à la terre travaillée, objet dissimulé de son désir. L’artiste est attiré par ce modèle qui lui révèle l’objet de son propre désir : la terre sous les pieds de ce paysan qu’il désire être tout en restant lui-même.
De même le nomade, être des flux figure le médiateur qui se croit attaché à une terre promise dans les lointains, là où l’herbe pousse : terre objet du désir du berger, transmuté en objet du désir de l’artiste par imitation du modèle de l’errant apatride déraciné ; mais le marin qui ne s’arrête nulle part est en fait attaché, enraciné à l’eau qui coule sous lui, avec lui.
[1] HEIDEGGER M op. cit. p. 44
[2] Ibid. p. 32
[3] Ibid. p. 15
[4] Ibid. p. 33
[5] Ibid. p. 34. La disponibilité, temps pendant lequel le fonctionnement du produit est digne de confiance, le produit-à-disposition n’est pas en panne, est proposée comme traduction de : die Verlässlichkeit. Elle implique le resserrement des lacets produisant la tension qui assure la solidité des souliers, leur fiabilité de l’usage pour la marche.
[6] HUGO V. : Stella, in : Les Châtiments
[7] Ibid. p. 36
[8] DERRIDA J. : Restitutions de la vérité en pointure, in : La vérité en peinture, Flammarion, Champs, 1978, p. 337
[9] ibid. p. 338-339
[10]www. jmsauvage. fr/arts/martin-heidegger-et-l’origine-de-l’œuvre-d’art
[11] DERRIDA J. : op. cit. p. 342
[12] SCHAPIRO M. : l’objet personnel, sujet de nature morte. À propos d’une notation de heidegger sur van Gogh, traduction publiée in Revue Macula 1978.
[13] DERRIDA J. : op. cit. , p. 320
[14] Dans un opuscule intitulé : « Pour réitérer les différences (l’Éclat), réponse à Derrida »concernant son interprétation de JL Austin, le philosophe américain J. R. Searle disciple de JL Austin, exprimait p. 1 sa dette à l’égard de H. Dreyfus et de D. Searle pour la discussion de questions austiniennes, et p. 3 expliquait que quand il assistait à un concert il communiquait avec son épouse par l’écriture, sur des bout de papier. Derrida a publié en réponse tout un livre guerrier intitulé : « Limited inc, a,b,c… » prétendument ironique (les 3 points sont signifiants) ; il imagine que J. R. Searle, H. Dreyfus qu’il dit connaître, et un certain D. Searle dont il demande : Qui est-ce ? auraient créé une SARL ! (lol) en éliminant les e muet de Searle. Derrida pouvait facilement vérifier dans les acknowledgements que D. était Mrs Searle qui se prénomme Dagmar : peut-être l’a-t-il fait, mais a tenu à développer son jeu de mots sur 300 pages, pas moins.
[15] Ibid. p. 327
[1] BALZAC H. : Le Chef d’œuvre inconnu, in : La Comédie humaine
[2] HEIDEGGER M. L’origine de l’œuvre d’art, in : Chemins qui ne mènent nulle part, Gallimard, 1962, pp. 81, 82 et 52,61
[3] ibid, p. 84
[4] SAINT EXUPÉRY A. : Le Petit Prince, Gallimard, 1946, p. 57