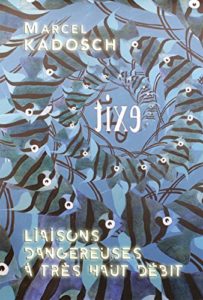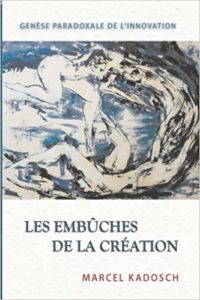En 1924, Élie abandonna un moment le métier d’instituteur pour mieux gagner sa vie, comme fondé de pouvoir de Si Hadj Omar Tazi, riche propriétaire de nombreux immeubles de rapport dans la ville de Casablanca. Son travail consistait à passer dans les immeubles pour encaisser les loyers. Les locataires qu’il rencontrait étaient souvent de pauvres diables qui n’avaient pas un sou pour payer. Il se laissait apitoyer, accordait des délais, et payait parfois de sa poche. Son patron finit par lui dire un jour:
—Je t’aime bien, Cadosch, mais tu n’es pas fait pour ce métier ! Tu ferais mieux de retourner à l’enseignement.
Il fit bien, car le métier était dangereux: en insistant pour encaisser on risquait de recevoir un coup de couteau.
Séjour au Maroc Espagnol
Mes parents revinrent ensemble à l’enseignement à Marrakech. Puis en 1926, Élie fut nommé directeur de l’Ecole de l’A.I.U. à El Ksar El Kebir, ville du Maroc espagnol sur les rives de l’oued Loukos.
Élie était un instituteur laïque, républicain, et franc maçon, vénérable d’une loge du Grand Orient Espagnol: il peignit le plafond du salon de son logement en bleu parsemé points jaunes figurant des étoiles, et ajouta un croissant de lune. Il portait un tablier orné d’une équerre et d’un compas, et le jour des « tenues » suspendait un squelette dans le cabinet éclairé d’une ampoule peinte en rouge, où le nouveau « frère » était invité à méditer sur la condition humaine pendant la cérémonie d’initiation. Ce fut mon expérience originale de la franc-maçonnerie.
Ce sont les seuls souvenirs précis que je garde de cette période. L’école maternelle n’existait pas. Je n’allais pas à l’école où mes parents enseignaient. Ils m’instruisaient à la maison en français. Je parlais assez mal l’espagnol avec le petit nombre de personnes que je fréquentais : ces circonstances étaient peu favorables à la communication, mais je m’en accommodais sans en souffrir. Je me fis au moins un copain : un petit voisin de mon âge me prêtait ses jouets, et des bandes dessinées en espagnol. Je me souviens d’un personnage: le chat Mia-u, et d’une histoire illustrée: « Nick Carter, détective ».
Je me rappelle avoir assisté à une verbena, sorte de kermesse dans un jardin. Un cerbère placé à l’entrée avait pour consigne de ne laisser passer que les invités. Un homme se présenta et voulut pénétrer sans carton. Le vigile le repoussa sans ménagement. L’homme nommé Salmon insista et fit l’important:
—Atencion ! Yo soy Salmon, de Larache !
—Y anque fueras Sardina, no pasarais, répondit le vigile.
En 1929, un différend survint un jour entre Élie et une institutrice de son école. L’altercation dégénéra en dispute, et l’institutrice forte en gueule, après avoir proféré des menaces, se rendit à la police pour dénoncer Élie Cadosch qu’elle accusa d’avoir insulté le roi !! L’affaire remonta jusqu’au Haut Commissaire, le général Queipo de Llano, qui était plutôt républicain à l’époque. Voulant étouffer l’affaire, il demanda qu’on veuille bien muter Élie vers une école du Protectorat Français. Mes parents furent donc envoyés provisoirement à Fez, avant que Élie prenne la direction de l’école de Sefrou déclarée vacante en 1931.
Séjour au Maroc français
Mes parents ayant l’intention de m’envoyer au lycée, on me présenta au concours des bourses: je fus reçu sans difficulté, mais on ne m’en accorda pas une parce que mes parents travaillaient tous deux, ils cumulaient deux salaires: privilège exorbitant par ces temps de crise. L’ennui était que la somme de ces deux salaires était inférieure à un seul salaire d’instituteur en France, l’instituteur français au Maroc touchant au surplus un tiers colonial. Entre temps Élie fut nommé directeur de l’école de Sefrou.
En 1931, Élie part à Paris à l’occasion de l’Exposition Coloniale mais pour se faire soigner les yeux à l’hôpital Rothschild. Il en rapporte un appareil photographique. à soufflet. Ce sera le début des albums familiaux. Autre élément de modernité: Dora fait désormais la cuisine sur un réchaud à pétrole Primus, équipé d’une pompe manuelle.
Le lycée le plus proche se trouve à Meknès: mes parents n’ont pas les moyens de payer la pension. En l’absence de bourse je reste à Sefrou pour faire à domicile le travail de la classe de sixième. On trouve une institutrice française bachelière, Mme Dessommes, qui me donne des leçons de latin et d’anglais. Je me débrouille tout seul pour le reste.
Mes parents croient bien faire en m’achetant une bicyclette, la première sur laquelle j’ai appris à rouler en vélo: malheureusement elle n’est pas munie des roues béquilles pour débutants, et n’étant pas doué pour l’équilibre je tombe tout le temps dès qu’on ne tient pas ma selle. Peu sportif, j’abandonne bientôt ce «jouet».
Sefrou a un jardin public, équipé d’un kiosque où un orchestre joue de la musique les dimanches. Son répertoire est limité aux valses viennoises, aux musiques de kiosque: Cavalerie légère et Poète et Paysan de Suppé, Sur le marché persan de Ketelbey. J’entends un jour la Rhapsodie hongroise n° 2 de Liszt: mon premier contact avec la musique « classique », c’est ainsi que les gens appellent la musique qu’ils trouvent ennuyeuse. Cependant mon oreille est enfin réveillée le jour où l’orchestre se produit pour accompagner une jeune violoniste qui interprète le concerto pour violon de Beethoven: je découvre ainsi par hasard à dix ans un monde nouveau, mais comme il est totalement inconnu de mes parents, rien ne s’en suivra ! [1]
Je repasse à nouveau en 1932 le concours des bourses et j’obtiens cette fois une petite bourse: 16 francs par trimestre: il me semble qu’elle est symbolique, mais mes parents m’affirment que grâce à elle ils pourront m’inscrire au Lycée de Meknès qui possède un internat. Je découvrirai par la suite que la qualité de boursier me confère divers avantages: livres gratuits, etc. .
Aux vacances de 1932, je me fais un ami: Jean Arnaud, dont le père est un fonctionnaire qui vient d’être affecté à Sefrou: Emile Arnaud est interprète, gazé de Verdun; il a épousé son infirmière Josette Sabatier. Par la suite j’apprendrai qu’elle est la fille du Professeur Paul Sabatier, Prix Nobel de chimie en 1912. mais pour l’heure je n’ai aucune idée de ce que peut être la chimie, et Jean Arnaud pas davantage : lui aussi est inscrit à l’internat de Meknès. Mme Arnaud nous y emmène en voiture automobile: c’est la première fois que je voyage dans une automobile particulière.
Dès le premier jour de mon arrivée, le 30 septembre 1932, je me suis fait un nouvel ami: Jean Venturini, fils de colon. Avec Jean Arnaud nous avons formé un trio inséparable pendant les deux années passées là-bas: Arnaud le sportif, qui se complaît dans le rôle de chef aux récréations; Venturini le poète, introducteur imprévisible de fantaisie; moi le fort en thème, oracle consulté à l’étude de fin d’après-midi comme la chouette de Minerve[2].
Après notre départ en 1934, Venturini a cessé d’attendre Celle- aux- yeux- de- pervenche et dédié à une fille aux yeux verts les poèmes dont il a commencé l’écriture. En 1939, il a publié un recueil de poèmes intitulé: Outlines[3]. Le 17 juin 1940, il a disparu en mer à bord du sous marin Morse.
Le recueil de poésies Outlines a été édité avec une préface dans laquelle je rappelle les événements de ce qui a été pour nous trois la fin de notre enfance, au milieu des myoporums qui entouraient la cour de récréation. Les souvenirs qui suivent me concernent moi-même.
Pour commencer, je mentionne un événement important de ma vie, survenu dès le 1er octobre 1932. À l’entrée en classe de 5ème, il fut demandé aux élèves de faire une rédaction et de répondre par écrit à quelques questions écrites au tableau noir: le but était de s’assurer qu’ils étaient capables de suivre le cours de cette classe. J’étais assis sur un banc au dernier rang: j’avais beau écarquiller les yeux, je n’arrivais pas à lire ce qui était écrit au tableau. Je parvins péniblement à déchiffrer quelque chose en tirant la peau à gauche et à droite des yeux. Au bout de quarante minutes, je me décidai à lever le doigt pour parler au maître surveillant:
—M’sieu, je vois pas ce qui est écrit au tableau.
—C’est maintenant que vous le dites !
Le surveillant leva les bras au ciel, me plaça au premier rang et me lut le texte. Je rédigeai une page, mais le surveillant s’étant renseigné sur moi revint me dire:
—Pas d’importance. Vous êtes boursier, vous n’avez pas à faire ce devoir.
On décida toutefois de prévenir d’urgence ma famille. Mon père vint voir ce qui se passait, et m’emmena chez l’oculiste: c’était un russe blanc avec un fort accent; il regarda mes yeux et demanda à mon père:
—Est-ce qu’il se touche ?
Mon père surpris se tourna vers moi:
—Est-ce que tu te touches ?
Moi sans comprendre:
—Je touche quoi ?
Mon père rassuré à l’oculiste:
—Il semble que non. N’insistons pas.
À cette époque on prétendait que la masturbation rendait aveugle. L’oculiste diagnostiqua une myopie de quatre dioptries et prescrivit le port de lunettes commandées aussitôt.
Je pus lire au loin à nouveau, au moins dans le champ des verres. Mais je découvris ma maladresse dans les jeux de balles: en particulier je ne pouvais pas jouer au rugby avec mes camarades, n’apercevant pas le ballon ovale hors du champ dans les passes sur le coté.
Nos conversations ordinaires à l’internat avaient pour sujets les dissensions entre petits et grands (à partir de la troisième), les rapports avec les pions, les tentatives de contact avec les filles internes dont nous étions séparés par un mur, les exploits de notre équipe de rugby et chincha la fava, notre jeu favori dans la cour de récréation.
Un jour de 1933 le groupe des petits décida que nous en avions assez d’être brimés par les grands; nous nous montions réciproquement le tête: cela ne pouvait plus durer, nous allions résister dès la prochaine récré ! La cloche sonna, nous courûmes depuis le préau en poussant un cri de guerre: « Sus aux Grands ! »
Assis au dernier rang, je sortis le premier et je me précipitai sur le premier grand rencontré, isolé au milieu de la cour, bayant aux corneilles: c’était André Giacomoni, de la classe de troisième. Je fonçai sur lui tête baissée: surpris il encaissa le choc puis me retint et ne tarda pas à me maîtriser étant beaucoup plus fort que moi. Pendant que je me débattais, je m’aperçus que mes camarades, loin d’en faire autant, avaient formé un cercle autour de notre lutte et m’encourageaient de la voix en riant: « Vas-y Cadosch, mords-lui l’œil, tue-le ! » Je me débattis sous Giacomoni qui finit par me plaquer au sol et me terrasser. Ce fut bientôt la fin de la récréation. Je me relevai dignement aux applaudissements des autres petits: « Bravo Cadosch ! » Mais je jurai en silence par devers moi que jamais, plus jamais, je ne me porterais au premier rang en avant d’une attaque, ne pouvant voir si les autres attaquants suivaient.
Ai-je tenu parole ? Je garde surtout le souvenir d’une soirée de 1955 où j’écoutais à la radio une interview de l’ex président du conseil Pierre Mendès France, récemment débarqué du pouvoir. On sait qu’après la défaite de Dien Bien Fu la majorité avait accepté la mort dans l’âme de porter au pouvoir PMF sur son engagement de signer rapidement la paix avec le Viet Nam. PMF avait ensuite essayé de mettre en œuvre sa propre politique pendant quelques mois, négocié l’indépendance de la Tunisie, pas vraiment soutenu par le peuple quand il avait essayé de convaincre les français de boire du lait plutôt que du vin, et en fin de compte fut chassé ignominieusement du pouvoir à l’initiative de René Mayer, avocat des colons : les députés qui avaient gardé un mauvais souvenir de ses causeries au coin du feu à la radio l’empêchèrent de parler à la Chambre après sa chute. L’interviewer lui rappelant ces faits, je retins la réponse amère de PMF: « Je ne serai plus jamais le syndic de la faillite des Autres ! »
A ces mots je ne pus me retenir de m’esclaffer: « Giacomoni !! » à l’ébahissement de mon entourage.
Scolarité
En cinquième, j’étais considéré comme excellent élève, mais j’ai rencontré un problème en quatrième. On m’a bien accordé le prix d’excellence, mais ma scolarité de gamin de treize ans n’a pas du tout été appréciée par le professeur de français: Mlle Pouget, vieille fille très réac, qui me notait sous la moyenne; les copains lui ont manifesté un jour leur étonnement:
—L’an dernier Cadosch avait toujours 15 ou plus, qu’est ce qu’il lui arrive?
—Mais c’est un indigène! répondit la prof. C’est déjà très bien qu’il écrive en français, sans faute d’orthographe, alors que ce n’est pas sa langue maternelle.
—Madame, rectifiai-je, je ne parle que le français: mes parents sont instituteurs et l’enseignent.
Là-dessus, elle nous demanda de rédiger pendant les congés de fin d’année un conte de Noël.
—Qu’est ce que c’est que cette histoire, et la laïcité? s’indigna mon père. Je vais écrire à M. Morillot (le proviseur).
—Laisse tomber, papa, je vais régler à ma manière.
Je trouvai un conte de Noël dans « La semaine de Suzette », journal lu par ma soeur: une dentellière prie la Vierge Marie, et le matin des cristaux de neige sur sa fenêtre dessinent un motif pour la robe de la princesse. Je le recopiai intégralement sans changer un mot. Cette fois Mlle Pouget me nota 18 et me regarda autrement; un moment j’ai cru qu’elle allait tenter de me convertir!
Satisfait de ma revanche, je ne soufflai mot de ma supercherie sauf à mes copains Arnaud et Venturini bien sûr, et à mon père qui me reprocha mon manque de respect.
Peu avant la fin de l’année scolaire, je trouvai dans ma boîte aux lettres un numéro de journal intitulé: Clarté. C’était le journal du Parti Communiste clandestin au Maroc et ce fut mon premier contact avec la politique. J’avais bien entendu parler de l’affaire Stavisky, et des graves troubles qui avaient eu lieu à Paris le 6 Février, mais je n’avais pas compris ce dont il s’agissait.
Le journal Clarté expliquait qu’il y avait des riches et des pauvres, mais que les riches exploitaient les pauvres en les faisant travailler pour un salaire de misère: juste de quoi manger pour avoir la force de travailler, et mettaient dans leur poche l’argent gagné sur leur dos en vendant le produit de leur travail. Cela me parut très injuste, et je devins bolchevik pendant un mois ; mais de plus amples explications de mon entourage me firent vite changer d’avis.
Le 30 juin 1934 Mme Arnaud vint chercher son fils et moi-même pour nous emmener à Rabat: son mari était nommé interprète à la Résidence générale, et Élie avait déjà été nommé directeur d”école à Rabat. Au passage je vois que le journal publie en première page sur six colonnes : « La nuit des longs couteaux : Le crépuscule des dieux ? » Qu’est-ce qui se passe dans le monde, en Allemagne ?
Je serais donc élève externe au Lycée Gouraud de Rabat ainsi que Jean à la prochaine rentrée.
À la veille de rentrer au lycée dans la classe de troisième, mes culottes courtes furent remplacées par des pantalons, et j’eus l’impression fugitive que les filles me regardaient différemment. Mais je ne disposais d’aucune expérience me permettant d’explorer ces possibilités nouvelles.
[1] Le nom de Jean Venturini figure sur une stèle au Panthéon.
[2] « Ce n’est qu’au crépuscule que la chouette de Minerve prend son envol » écrit le philosophe Hegel (XIX°) : « la philosophie vient toujours trop tard : elle apparaît seulement lorsque la réalité a accompli et terminé son processus de formation », donc après le scientifique, le technicien, comme témoin commentateur.de l’homme d’action.
[3] VENTURINI J.: Outlines, Vaillant , Nice, 2009