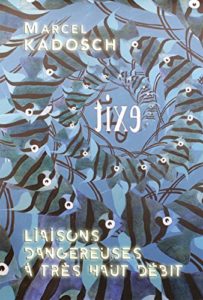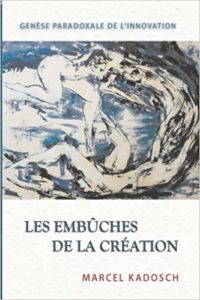La recherche scientifique est une voie relativement droite, mais où l’on peut participer à quelques illusions, vivre quelques situations semées d’embûches, matérielles ou humaines, qu’elles aient ou non été instructives. Je cite ci-dessous quelques obstacles rencontrés par des chercheurs tentant d’élaborer une vérité scientifique.
Origines
Né au Maroc, j’ai appartenu là-bas à cette catégorie de jeunes louée par le critique littéraire du journal Le Temps Paul Souday, qui ont très bien su le grec et le latin à dix sept ans et ont tout oublié ensuite. Par la suite je suis arrivé à Paris rive gauche qui m’a séduit parce que j’étais francophone, imprégné de culture gréco-latine tendance Bailly-Gaffiot, et je m’y suis fixé.
J’ai connu ma première heure de gloire au lycée de Rabat, capitale du Maroc, à l’époque du Front Populaire en 1937, dans les circonstances décrites ci-après : elles révèlent l’existence dès cette époque lointaine d’un désir d’imitation de modèle, qui a joué le rôle du plus important moteur de recherches dont j’ai été acteur et /ou témoin.
Comme tous mes camarades je suivais avec passion les péripéties du Tour de France cycliste, les exploits des forçats de la route : de loin, d’abord à la T. S. F. puis le lendemain dans le journal local. Je n’avais pas de vélo et savais à peine m’en servir : je n’en rêvais pas moins par procuration de gagner des étapes, sauf celles contre la montre, et prenais le maillot jaune comme modèle à imiter dans les domaines où j’étais capable de prendre la tête du peloton.
Mon professeur de lettres, nommé Robert Roget, m’avait présenté au Concours Général des Lycées et Collèges de France et des Colonies en version grecque et latine, et Raymond Badiou, professeur de mathématiques, pour sa matière : j’assimilai aussitôt cette lutte contre d’autres élèves anonymes à des étapes contre la montre. Je fus très satisfait de ma prestation en grec, et j’ai caressé pendant quelques semaines le rêve d’un dixième ou quinzième accessit qui m’aurait comblé de bonheur. Je me doutais que ma bonne performance devait beaucoup à l’aide du dictionnaire grec-français Bailly, dont tous les candidats avaient bénéficié comme moi, mais je n’avais qu’une faible conscience du fait que beaucoup de français colonisateurs disposaient de capacités de style bien plus étendues que celles du colonisé que j’étais à l’époque du fait de mon lieu de naissance et de séjour, et n’avais donc aucune chance d’un classement privilégié.
Le jury du Concours Général m’a décerné un troisième prix de mathématiques. Au même moment pratiquement naquit Alain Badiou, devenu par la suite un philosophe célèbre, sensible aux abstractions mathématiques. Quelques semaines après le télégramme annonciateur, le journal Le Temps publia les résultats in extenso, et je m’aperçus que le jury n’avait pas accordé de premier prix, ni de deuxième prix : personne n’avait fait mieux que moi. Je me rappelle m’être écrié :
— Je suis le Roger Lapébie des mathématiques !
Cette année-là en effet le Tour de France cycliste fut gagné par ce fameux coureur sprinter, mais le maillot jaune avait été porté jusqu’aux Alpes par un coureur italien nommé Gino Bartali, qui fut ensuite victime d’un accident en montagne. La course fut alors menée par le coureur belge Sylvère Maès, qui avait gagné le Tour l’année d’avant. Mais le public français se montra chauvin et avec la complicité des organisateurs persécuta Maès, qui après l’arrivée à Bordeaux, excédé, claqua la porte du Tour suivi par toute l’équipe belge pour rentrer à Bruxelles.
C’est ainsi que Roger Lapébie remporta ce Tour, alors qu’il aurait dû finir troisième, derrière Bartali, qui gagna le Tour l’année suivante, et Maès qui le remporta à nouveau à la veille de la guerre.
Pourquoi cette exclamation inattendue pour une place virtuelle de troisième ? Prenant comme modèle externe ce Lapébie qui volait la victoire, je voyais en lui une sorte de Prométhée volant le feu aux Dieux du moment, j’ai crié que j’étais Lapébie, comme Cathy a crié qu’elle était Heathcliff dans le roman d’Emily Brontë.
Les matières littéraires m’attiraient davantage. Mais Robert Roget fut le premier à me dire en ce jour de gloire que j’avais tort, car l’avenir était promis aux scientifiques. C’était ce qu’il croyait : tandis que la guerre d’Espagne et les bruits de bottes fascistes faisaient ressentir le besoin urgent de canons, d’avions, alors que la France manquait de salles de bains et que les cabinets étaient souvent à l’extérieur, des journaux d’anticipation nous faisaient miroiter un avenir de machines à laver et d’air conditionné qui ne se réalisa que vingt ans plus tard. Je déclarai que j’aimerais bien être ingénieur, suscitant un tollé auprès de mes camarades qui se récrièrent en chœur :
— Tu n’y penses pas, un métier de crève-la-faim ! Les ingénieurs de Centrale sont embauchés comme ouvriers tourneurs ou fraiseurs chez Renault et Citroën.
C’était vrai depuis la crise des années 30, mais le vent commençait à tourner à cause de Hitler, et de Franco. J’avançai que j’étais tenté par la Recherche Scientifique : le gouvernement du Front Populaire contenait comme sous-secrétaire d’état à la Recherche Irène Joliot-Curie, qui peu attirée par le pouvoir céda la place à Jean Perrin qui créa le Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS).
Mes camarades m’écoutèrent avec pitié :
— La Recherche Ashendifik ? (i.e. en arabe marocain : Qu’est-ce qu’on en a à foutre ?)
Ce commentaire fut suivi de leurs bons conseils :
— Choisis un métier de prestige : Avocat !! Médecin ! Professeur même (il touchait en plus d’émoluments conséquents un tiers colonial, habitait une belle villa et roulait en voiture américaine)…
Dans les années suivantes, j’ai dû admettre avec humilité mes limites, ne parvenant pas à suivre des cours de philosophie auxquels je ne comprenais rien, contrairement à mes condisciples qui répondaient au professeur avec une aisance qui excitait ma jalousie : je croyais entendre des dialogues de Socrate avec ses disciples selon Platon.
Appelé par la suite à venir en France en janvier 1945, arrivé en mai 1945 et après avoir acquis mes diplômes, je dus reconnaître qu’en effet le métier de chercheur au Centre National de la Recherche Scientifique était au lendemain de la guerre dépourvu de prestige et au surplus très mal rémunéré. Si j’avais rejoint le CNRS, on m’aurait sans doute aiguillé vers le mouvement Bourbaki qui se proposait d’introduire une grande rigueur dans les mathématiques, en mettant entre parenthèses la physique, ce qui m’inspirait une grande méfiance : n’était-ce pas ce qu’avait tenté jadis Parménide, rapporté par Platon, et plus tard par Paul Souday en des termes peu engageants sur les propriétés exclusives de «l’Un»? Peu tenté par une vocation de pur esprit, je souhaitais d’abord me tenir au courant des méthodes d’application des mathématiques à la physique. On commençait à parler de machines à calculer aux performances extraordinaires, que les Alliés avaient utilisées avec succès pour déchiffrer le code secret de la Wehrmacht, et pour construire la bombe atomique : comment ne pas être séduit, tenté d’accéder à ce royaume… Dès mon arrivée à Paris, je m’étais rendu au consulat des États Unis et j’avais entamé les démarches pour m’inscrire à l’Université Stanford de San Francisco : un professeur L. Pipes y avait monté un laboratoire d’analogies entre les machines mécaniques et les circuits électriques, et un professeur G. Kron en avait développé la mathématique ; d’où l’illusion que ce pouvait être une voie d’accès à ces machines merveilleuses.
En attendant, il fallait vivre, et sur le conseil d’un camarade, j’ai sollicité un emploi à un Groupe d’Etudes des Moteurs à Huile Lourde (GEHL) situé à Suresnes, qui agréa ma demande. Dépourvu d’argent, je remis avant terme le mémoire de fin d’études pour obtenir le diplôme d’ingénieur civil des mines fin Mars 1946, et gagner de quoi me vêtir d’un costume décent.
Quand je me suis présenté au GEHL début Avril, son chef Raymond Marchal, venait d’être nommé Directeur Technique de la Société Nationale d’Etudes et de Construction de Moteurs d’Avion (SNECMA)), prenant la succession de la Société Gnome et Rhone nationalisée, qui absorba le GEHL. J’ y ai été embauché à ma demande comme ingénieur débutant de recherches.
Le premier travail qu’on me confia consista, dans la pénurie ambiante au lendemain de la guerre, à « chercher » du matériel introuvable avant longtemps, pour monter un laboratoire d’analyse des déformations subies par les matériaux utilisés : il y avait maldonne, ce n’était pas ainsi que j’avais vu le métier de chercheur. Le GEHL avait passé commande d’un banc de photoélasticité à un constructeur qui me déclara que ce banc serait livré en 1949 : dans trois ans !
Professeur Cosinus
Mon employeur avait établi une relation avec le sous-directeur de l’École Nationale du Génie Maritime, qui s’appelait Jean Hély. C’était le nom du plus brillant lauréat du Concours Général, désigné en 1926. Je demandai à le rencontrer : ce fut l’occasion de faire la connaissance d’un homme extraordinaire. Son discours me rappela celui du professeur Cosinus inspiré à Christophe (Colomb), auteur de la bande dessinée de ce nom, par le savant Henri Poincaré.
Apprenant que je voulais être chercheur scientifique et que la SNECMA employait peu mes talents supposés, Jean Hély m’encouragea à l’étude de la physique théorique, et me fit lire en 1947 tous les travaux du prince Louis de Broglie, pionnier de la mécanique quantique et grand patron des physiciens français. J’acceptai de consacrer jusqu’à nouvel ordre mon temps libre à aider Jean Hély dans ses travaux, et me plongeai dans les équations de Maxwell, Schrödinger, Pauli, Heisenberg, Dirac, etc.
Jean Hély était engagé dans une controverse avec Louis de Broglie et ses disciples à propos de la théorie de la relativité générale d’Einstein.
Résumons l’objet de ce débat en 1947 : après avoir expliqué l’électromagnétisme par une théorie de la relativité restreinte, limitée aux mouvements uniformes, qui fondait l’espace et le temps en un espace-temps, Einstein proposait d’expliquer la gravitation par l’accélération des corps résultant d’une déformation géométrique de cet espace-temps, doté d’une courbure, puis d’une torsion. L’objectif de la théorie était d’expliquer le phénomène de manière plus satisfaisante que par une force magique agissant de manière mystérieuse à distance sur des corps matériels comme le proposait la mécanique de Newton, mais plutôt par des propriétés physiques, autres que celles géométriques, de tout l’espace, plutôt de l’espace-temps où ces corps étaient placés, comme celles que Faraday avait mises en évidence avec de la limaille de fer autour d’un aimant : propriétés qui faisait de l’espace-temps un objet physique, appelé champ. La théorie de la relativité générale rendait compte de phénomènes non expliqués par la loi de gravitation de Newton, comme le déplacement du périhélie de Mercure. Mais Einstein n’était pas encore parvenu à présenter une théorie unique, expliquant à la fois l’électromagnétisme et la gravitation, qui constitue un rêve moniste des physiciens. Divers scientifiques tentaient donc de chercher une explication par une autre théorie unitaire.
Jean Hély avait tenté d’en proposer une en 1937, renonçant à représenter la gravitation par une courbure de l’espace-temps, et faisant habiter un espace-temps euclidien par des particules à spin : propriété quantique conférée à cet espace-temps dont je rappelle l’idée par analogie avec une image : le spin d’une particule évoque sa symétrie quand on la regarde de tous les cotés. Une particule de spin 0 est vue comme un cercle, identique à elle-même sous tous les angles. Une particule de spin 1 est vue comme une lettre de l’alphabet ou une flèche : elle reprend son aspect quand on lui fait accomplir un tour complet.
La théorie de Jean Hély voulait expliquer à la fois les propriétés du champ électro-magnétique, qui dérive d’un « potentiel vecteur », ayant l’aspect des lettres de l’alphabet, et celles d’un champ de la gravitation newtonienne dérivant d’un potentiel scalaire (spin 0) ayant le même aspect sous tous les angles. Mais certaines lettres reprennent déjà leur aspect après chaque demi-tour : H, O, X, I sans le point ; l’analogie leur fait représenter une particule de spin 2 (deux demi-tours). Ces particules-champs représentent une sorte de « fond », où agissent d’autres particules mobiles, nommées fermions, dont le spin est ½ : elles ne reprennent que la moitié de leur aspect après un tour complet, et font un deuxième tour virtuel pour redevenir elles-mêmes : une « forme », autour d’une certaine matière. On commençait justement à étudier la particule-champ de spin 2, baptisée «graviton» en pensant qu’elle pourrait servir à remplacer la gravitation conçue comme une force. Jean Hély retint la représentation de la gravitation par un champ scalaire de particules de spin zéro parce qu’elle était plus simple ; mais son recours à deux spins ne se prêtait guère à une explication unitaire de deux champs.
Il y avait alors très peu de «forces» non expliquées par la loi de gravitation de Newton : deux ou trois. Jean Hély avait en somme «bricolé» une loi ad hoc rendant compte de ces phénomènes mais sans en tirer une hypothèse sur leur cause : c’était une théorie scientifique au sens de Popper, inductive, en attente d’explication ou de réfutation. Oubliant que c’était déjà le constat de Newton sur la gravitation newtonienne par action à distance (« Hypotheses non fingo ») avant l’explication par la relativité générale, le prince Louis de Broglie et son équipe avaient rejeté le modèle de Hély, mais le prince qui avait la haute main sur tous les journaux scientifiques avait eu en outre le tort de s’opposer à la publication des articles de Jean Hély, au motif qu’ils ne reposaient selon lui sur aucune base sérieuse, de sorte qu’ils restèrent ignorés du public scientifique au lieu d’être examinés et critiqués, fût-ce négativement.
Le graviton qui expliquait tout en 1945
Or un savant américain très connu, Georges Birkhoff, avait proposé une théorie unitaire intéressante, peu de temps avant de décéder en 1944. Jean Hély parvint à publier dans une revue un exposé de cette théorie[1], qui rendait compte dans un espace-temps euclidien des phénomènes astronomiques non expliqués par la loi de Newton.
Le débutant que j’étais se scandalisa de constater que la gravitation de Birkhoff équivalait à une force newtonienne qui n’était pas dirigée d’un corps vers l’autre comme le voulait une loi de Képler ; puis je m’aperçus que sa théorie revenait à déduire l’électromagnétisme en même temps que la gravitation des propriétés de particules-champs élémentaires de spin maximum égal à 2, pouvant donc prendre les valeurs 0,1,et 2 : un «spineur», principe plus explicatif donc plus crédible que le champ de spin 0 ou 1 de Jean Hély. Ce fut l’occasion d’écrire dès 1947 un premier article scientifique sur cette théorie, de portée fort modeste[2], mais susceptible de faire connaître mon existence. Je commençais à envisager de quitter la SNECMA, où je ne faisais rien d’intéressant, pour faire de la recherche dans le domaine de la physique théorique, mais je n’étais connu que de Jean Hély, dont personne ne voulait publier l’œuvre et avec qui personne ne voulait travailler !
Dès les années 30, Jean Hély s’était révélé comme un jeune physicien brillant qui aurait pu contribuer à l’avancement de la physique en France. Il n’a jamais mis en question les fondements de la relativité restreinte et des quanta, comme tant de contestataires farfelus cherchant à faire parler d’eux. Il a essayé de formuler une loi expliquant à la fois la gravitation et l’électromagnétisme en partant d’autres considérations que celles d’Einstein qui n’y arrivait pas alors. Mais en utilisant les quanta comme un bricoleur, excommunié sur le champ, il a été interdit d’entrée au château. Il n’a pas accepté son sort de victime émissaire, son existence niée par la foule des fidèles, comme dans la Bible celle de Job qui risqua de voir son nom effacé pour avoir «suivi la route antique que foulèrent les hommes pervers[3]». Il s’est plaint d’être persécuté, dressant contre lui la plupart des habitants du château, un peu par sa faute quand même en se posant comme victime avec quelque masochisme.
La Lumière fatiguée
En 1947 quelques amis de Jean Hély, et son directeur, outré de voir que personne ne voulait publier son sous-directeur, ont tenté de le défendre et ont demandé à Yves Rocard, directeur du Laboratoire de physique de l’École Normale Supérieure et anticonformiste notoire, d’organiser un colloque réunissant le gratin de la gravitation.
Yves Rocard était assisté depuis peu par Pierre Aigrain qui venait des États Unis et lui était affecté pour installer un laboratoire de physique des solides. Jean Hély exposa sa théorie sous la présidence d’Yves Rocard, qui n’intervint pas et laissa Pierre Aigrain interrompre son exposé pour déclarer que sa théorie était indéfendable : j’entendis un jeune chercheur aux dents longues qui avait tout de suite repéré en Hély un loser, et s’était employé de son mieux à l’enfoncer, avec l’aide ultérieure d’un autre jeune loup, Jean-Claude Pecker, qui joua le rôle de sacrificateur en publiant une démolition en régle du travail de Jean Hély.
Or cet astrophysicien connu comme défenseur de l’information scientifique en pourfendant l’astrologie, les soucoupes volantes et autres fausses sciences, est parti plus tard en guerre contre la théorie du Big Bang en avançant des arguments qui, mutatis mutandis, ressemblaient furieusement à du Jean Hély. Le Big Bang, affirmait-il à l’appui de ses critiques, est la science officielle, ne tolérant aucun doute, raflant tous les fonds, ôtant aux contradicteurs les moyens d’examiner la validité des alternatives. Jean-Claude Pecker adhère à l’explication de la loi de Hubble du décalage vers le rouge du spectre des nébuleuses lointaines par l’idée avancée par le suisse Zwicky que la lumière se fatigue en traversant un espace qui n’est pas vide, ce qui la fait rougir : idée qui paraissait digne d’intérêt aux yeux de Jean Hély aussi, mais que contredisent de nos jours les mesures par le satellite COBE (Cosmic Background Explorer) du fonds diffus cosmologique : le rayonnement électromagnétique, qui a dû être émis dans l’univers primitif avec un spectre correspondant à l’équilibre thermique, aurait du être déformé au bout de milliards d’années dans l’hypothèse de la lumière fatiguée, mais non dans celle d’une expansion de l’univers. Or on observe qu’il ne l’est pas : il est l’exemple le plus parfait de spectre de corps noir, à la température basse de 2,7°K due à l’expansion. Les anti-Big Bang confrontés à ce résultat contradictoire avancent alors l’hypothèse que le rayonnement mesuré par COBE est d’origine locale, provenant de notre seule galaxie.
Gravitons et Spins de Jean Hély, de Georges Birkhoff, Lumière fatiguée de Zwicky: autant d’exemples de ce que j’appelle créations illusoires, qui dans leur contexte n’ont pas servi à ce jour les buts assignés à une étude explicative de phénomènes naturels.
En fin de compte ce Birkhoff fut le seul travail de recherche scientifique dite «fondamentale» que j’ai eu l’occasion d’entreprendre, et qui se révéla vite infructueux, semblant donner raison à mes camarades de lycée au Maroc : la recherche ashendifik ? à quoi ça sert ? Ça m’a servi à faire la connaissance du milieu scientifique : la grandeur de ses rêves, la petitesse et la trivialité de certains de ses travers humains. Mais je n’ai pas eu à regretter d’avoir abandonné ce graviton « euclidien » : à ce jour on n’a pas prouvé son existence. Et surtout notre motivation a disparu entre temps. Présenté comme une particule dont le champ pouvait expliquer la gravitation sans recourir à un espace-temps doté d’une courbure ni d’une torsion, le graviton de spin 2, création illusoire, n’a plus rendu ce service qu’on attendait de lui : le physicien Richard Feynmann a montré que bien au contraire en essayant de construire sans a priori une théorie consistante du champ d’un graviton hypothétique sans masse, on arrivait à démontrer la relativité générale d’Einstein [4] qui apparaissait comme une conséquence ! La découverte récente des ondes gravitationnelles l’a remise en actualité.
Depuis, j’ai décidé de ne rechercher scientifiquement, que pour aider à comprendre comment marche un objet artificiel : i.e. dont on avait préalablement découvert qu’il pouvait bien servir à quelque chose…
Suite => De l’Explication
[1] HÉLY J. : La théorie de Birkhoff in La Revue Scientifique, 86,1948, pp. 115-120; reproduite ici dans le thème: Science, sous-thème: Physique
[2] KADOSCH M. : Sur la théorie de Birkhoff in La Revue Scientifique, 86, 1948, pp. 707-710; reproduite ici dans le thème: Science, sous-thème: Physique
[3] GIRARD R. : La route antique des hommes pervers, Grasset,Paris, 1985,p. 21.[7]
[4] FEYNMAN R. P. : Leçons sur la gravitation, Odile Jacob, Paris, 2001, pp. 8, 102, 138.